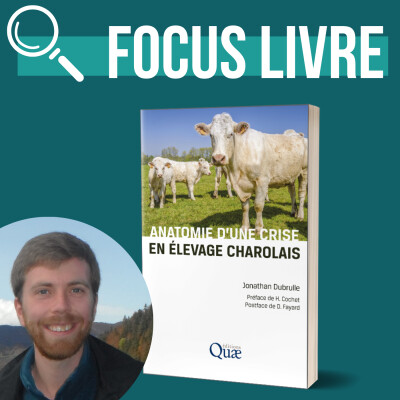Description
Les éditions Quae vous présentent 40 idées fausses sur les requins, ouvrage de Johann Mourier, lu par Jordan Hachet. Dans cette série d'épisodes, les éditions Quae vous invitent à décrypter les fausses croyances qui circulent sur les requins. Nous découvrirons ici que si dans la plupart des sociétés occidentales, le requin est synonyme de danger, de nombreux peuples à travers le monde ont une tout autre perception des requins.
Quae Vox : paroles de sciences, un podcast des éditions Quae.
👉 Retrouvez nos ouvrages sur quae.com et quae-open.com, et suivez nos actualités sur Instagram, Facebook et LinkedIn.
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.