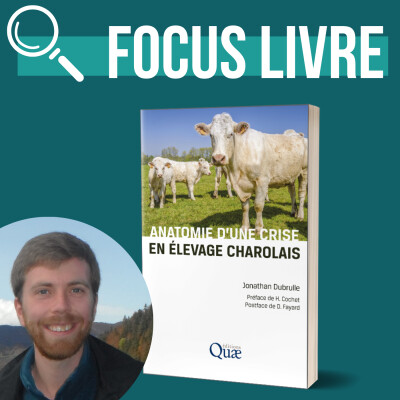Description
Créée il y a plusieurs siècles, et présente sur tous les continents, la bière est de ce fait une boisson multimillénaire et universelle.
Dans cet épisode, Jean-Paul Hébert nous raconte les apports des brasseurs à la science.
📖 Jean-Paul Hébert est auteur de "Toutes les bières moussent-elles ?" et "Des bières et des hommes"
👉 Retrouvez ces livres sur quae.com !
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.