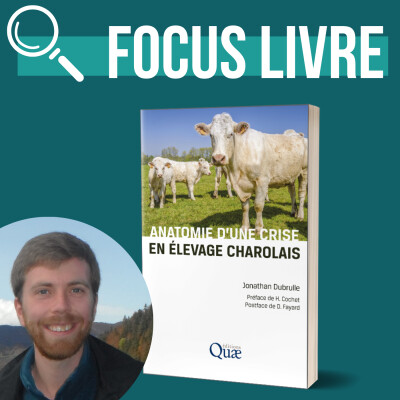Speaker #0Que savez-vous des zoonoses, ces maladies transmissibles entre les humains et les animaux ? Dans cette série d'épisodes, les éditions Quae vous proposent un éclairage sur ce sujet d'actualité. Que sont les zoonoses ? Quels animaux peuvent les transmettre ? Parmi elles, quelles sont les zoonoses virales ?
[Musique] QU’EST-CE QU’UNE ZOONOSE ? Le mot « zoonose » vient des racines grecques ζῷον (zôon, animal) et νόσος (nosos, maladie). Dès la Haute Antiquité, la possibilité de transmission de certaines maladies de l’animal aux humains est évoquée, notamment dans le cas de la rage, mais c’est au xixe siècle que les concepts de microbes, de contagion, d’infection et de transmission apparaissent, au moins dans leurs sens contemporains, ouvrant la voie à la microbiologie et à l’épidémiologie. C’est le médecin et chercheur allemand Rudolph Virchow (1821-1902) qui proposa le terme de zoonose après avoir constaté l’existence de liens entre une maladie parasitaire présente chez les porcs et les humains, la trichinellose. Aujourd’hui, on définit une zoonose (ou maladie zoonotique) comme une maladie infectieuse ou parasitaire dont les agents microbiens ou parasitaires se transmettent naturellement entre les humains et les animaux. Dans cet ouvrage, nous allons considérer les transmissions entre humains et animaux vertébrés (essentiellement mammifères et oiseaux), en cohérence avec la définition donnée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). On peut préciser ici que le terme « naturellement » s’oppose à la fois à « expérimentalement » et à « exceptionnellement ». C’est ainsi que ce terme sera compris et utilisé dans le contexte de ce livre. Les zoonoses existent depuis que les humains existent. Les espèces ancestrales du genre Homo, certainement également les australopithèques ainsi que les diverses lignées présentes au sein des hominidés, ont été confrontées à des agents pathogènes venant d’autres groupes zoologiques. Les humains vivaient au contact des animaux bien avant qu’Homo sapiens ait pris conscience de lui-même. Pendant une très longue période, l’anthropologie nous apprend que, du point de vue humain, la frontière entre humains et autres animaux n’existait pas ou était fluctuante, selon les contextes, les régions, les époques. Des études qui datent du milieu des années 2010 réalisées au nord de l’Australie sur le virus Hendra, parmi des populations indigènes qui peuvent encore exprimer un mode de vie proche des pratiques pré-européennes, illustrent la grande différence du regard que portent les anciens Australiens d’un côté et les nouveaux Australiens de l’autre sur une maladie virale. Le réservoir de ce virus est constitué par de grandes chauves-souris frugivores appelées « roussettes » ou « renards volants » (genre Pteropus). La régression des forêts tropicales et la plantation de vergers par les colons européens ont rapproché les roussettes des zones habitées. Les cas humains sont associés à un premier passage du virus à des chevaux, importés en Australie par les Européens. Les populations indigènes, qui chassent les roussettes en respectant certaines pratiques, les associent à des éléments positifs de leur environnement. Elles semblent d’ailleurs ne jamais avoir souffert de ce virus, dont la présence en Australie est pourtant très ancienne. À QUOI SONT DUES LES ZOONOSES ? Les zoonoses sont dues à des agents pathogènes transmis entre les humains et les animaux. Il peut s’agir de micro-organismes invisibles à l’œil nu (les bactéries, les virus, les champignons microscopiques, les prostistes protozoaires, les prions) ou de parasites de plus grande taille (tels que des vers helminthes ou des arthropodes parasites). Nous parlons d’« agents pathogènes », mais il serait plus correct de les nommer « agents potentiellement pathogènes ». Ces agents ne seront pathogènes que dans certaines conditions, chez certaines espèces et chez certains individus. C’est l’interaction entre l’agent et l’hôte, c’est-à-dire l’individu infecté, qui induit la pathogénicité. En effet, les micro-organismes font partie de notre environnement et sont présents dans nos corps. L’immense majorité des micro-organismes ne rendent pas malade, bien au contraire, ils jouent des rôles indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. C’est le cas des micro-organismes dits « symbiotiques » ou « commensaux », qui constituent notre flore normale, ou microbiote, de l’intestin ou de la peau par exemple. Depuis les années 2000, les chercheurs ont toutefois identifié quelques espèces animales, notamment des arthropodes possédant peu ou pas de microbiote. Chez les humains, on compte 10 puissance 12 micro-organismes abrités par le tube digestif, soit deux à dix fois plus que le nombre de cellules constituant le corps, qui jouent un rôle dans la digestion et l’immunité. Le corps d’un humain sain adulte abrite aussi plus de trois mille milliards de virus, pour la plupart des bactériophages qui infectent les bactéries dans le tractus intestinal et les muqueuses. Notre génome héberge aussi des endovirus, ou rétrovirus endogènes, incorporés dans notre ADN depuis plus de 30 millions d’années. Leurs séquences représenteraient 8 % de notre génome. Ils sont en général non pathogènes pour l’humain et certaines séquences seraient même bénéfiques. C’est le cas du virus HERV-W, qui participe à des mécanismes physiologiques et assure la formation du placenta. Dans une étude publiée en 2001, Louise Taylor et ses collaborateurs ont estimé qu’un tiers des agents pathogènes zoonotiques chez les humains seraient des bactéries. Les bactéries sont des êtres vivants composés d’une seule cellule (unicellulaires) dont la taille est de l’ordre du micromètre (μm), c’est-à-dire un millième de millimètre. Elles contiennent un chromosome constitué d’ADN non isolé dans un noyau et sont entourées d’une paroi caractéristique. Sauf exception, ce sont des organismes autonomes qui se multiplient par division, à une vitesse parfois très rapide, de l’ordre d’une division toutes les 30 minutes. Les bactéries sont présentes partout dans l’environnement, et seule une petite partie d’entre elles sont pathogènes, comme les agents de la tuberculose. Elles sont normalement sensibles aux antibiotiques. Un tiers des agents pathogènes zoonotiques chez l’humain seraient par ailleurs des vers, ou helminthes. Ce sont des vers ronds (nématodes comme les trichines) ou plats (cestodes comme les ténias et trématodes comme les schistosomes) généralement visibles à l’œil nu sous leur forme adulte. Ils sont essentiellement parasites de l’appareil digestif, du sang et de divers tissus. Ils ont parfois des cycles de transmission complexes faisant intervenir des hôtes d’espèces variées. Ils sont traités à l’aide de molécules antihelminthiques (on parle de vermifuges dans le cas particulier des vers gastro-intestinaux). Selon les cas, les humains « jouent » le rôle d’hôtes définitifs, c’est-à-dire qu’ils hébergent les adultes reproducteurs, d’hôtes intermédiaires en hébergeant les larves, et parfois d’hôtes « culs-de-sac épidémiologiques », car ils ne permettent pas de transmission ultérieure. COMMENT SONT CHOISIS LES NOMS DES NOUVELLES MALADIES INFECTIEUSES ? Par le passé, les noms des nouvelles maladies infectieuses étaient bien souvent liés aux endroits où les maladies ou les agents pathogènes avaient été identifiés pour la première fois : fièvre hémorragique de Crimée-Congo (maladie identifiée en Crimée, virus isolé au Congo), borréliose de Lyme (maladie identifiée dans la ville de Lyme, Connecticut, aux États-Unis), infection à virus West Nile (virus isolé en Ouganda, parfois connu sous le nom du virus du Nil occidental) … Pourtant, cette dénomination ne représente pas la réalité épidémiologique, ni même nécessairement l’origine géographique. Par exemple, la grippe espagnole de 1918 fut baptisée ainsi car l’Espagne fut le premier pays à la mentionner publiquement. Or elle était apparue vraisemblablement aux États-Unis. Nombre de maladies sont également nommées en référence à l’agent pathogène étiologique (exemples : tuberculose, toxoplasmose), qui peut lui-même tenir son nom de son découvreur. Enfin, certains noms de maladies font référence à l’espèce animale impliquée dans la transmission aux humains, comme la grippe porcine. Mais depuis 2015, l’OMS, en étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE en référence à son ancien nom, l’Office international des épizooties), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO, pour Food and Agriculture Organization en anglais) et les experts de la Classification internationale des maladies (CIM), recommande des pratiques de dénomination des nouvelles maladies infectieuses humaines qui évitent de stigmatiser des peuples, des nations, des zones géographiques ou des espèces. Le nom officiel est in fine attribué par la CIM. Ainsi, ce qu’on appelait la « grippe porcine » ou « grippe mexicaine », qui a fait son apparition au Mexique en 2009, fut nommée officiellement « grippe A(H1N1)pdm09 ». Les virus représenteraient un agent pathogène zoonotique sur six. De très petite taille (inférieure à 0,1 μm), ils sont constitués d’acides nucléiques, ces macromolécules porteuses d’information génétique (ADN ou ARN), entourés d’une capside formée de protéines et, pour certains virus dits « enveloppés », d’une enveloppe lipidique. Ce sont des parasites obligatoires qui ont besoin pour se multiplier d’infecter une cellule et donc perturbent généralement le fonctionnement normal de l’hôte. Le virus de la rage est un exemple de virus zoonotique emblématique. Des molécules antivirales peuvent parfois être utilisées pour bloquer leur cycle de réplication, mais la prévention des infections repose surtout sur le blocage des chaînes de transmission et la vaccination quand elle existe. CARACTÉRISTIQUES DES VIRUS ZOONOTIQUES Les virus zoonotiques sont plus fréquemment des virus à ARN qu’à ADN, car leur évolution génétique est facilitée par de nombreuses erreurs de réplication qui ne sont pas corrigées. Ils se multiplient plutôt dans le cytoplasme de la cellule, sans devoir entrer dans le noyau. Ils n’ont ainsi que la membrane cellulaire à franchir, ce qui faciliterait leur aptitude à infecter plusieurs espèces. La majorité des nouveaux virus à potentiel épidémique sont liés à (mais pas directement issus) d’autres virus transmissibles dans les populations humaines. Ceci étant, les différences de séquences entre agents pathogènes zoonotiques et non zoonotiques sont parfois très faibles. Par exemple, on dénombre 29 nucléotides de moins chez le SARS-CoV-1Coronavirus 1 du Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), Sever Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 1 en anglais, pathogène pour les humains, que dans un coronavirus proche présent chez les civettes palmistes masquées (Paguma larvata), non pathogène pour les humains. La lecture des seules séquences génétiques donne donc des indications sur le potentiel zoonotique d’un virus, mais ne permet pas en l’état de faire des prédictions sur les émergences. Les champignons microscopiques représenteraient un agent pathogène zoonotique sur dix chez l’humain. Ils sont caractérisés, comme les autres champignons, par l’existence d’une paroi et par la possibilité de se disséminer sous la forme de spores. Ils se développent sur la matière organique en décomposition, vivent en symbiose avec d’autres organismes ou font partie de la flore digestive, cutanée ou génitale des animaux et des humains. Certains peuvent être pathogènes, comme la teigne ou l’aspergillose, en particulier chez des individus immunodéprimés, chez lesquels ils provoquent des mycoses au niveau de la peau, des muqueuses ou de certains organes. Les molécules utilisées pour lutter contre les champignons sont appelées « antifongiques ». Nous n’avons pas développé spécifiquement d’exemple dans le livre, mais nous en mentionnerons en particulier dans le paragraphe sur la transmission par contact .Les protozoaires représenteraient environ 5 % des agents zoonotiques. Ce sont des organismes unicellulaires complexes qui, contrairement aux bactéries, possèdent un noyau contenant des molécules d’ADN portées par des chromosomes. Leur taille varie entre un micromètre et un millimètre. Ils sont présents dans les sols et les milieux aquatiques, et seule une petite proportion d’entre eux est pathogène pour les humains ou les animaux. Certains sont des parasites stricts. Comme leur métabolisme est proche de celui des vertébrés, les molécules auxquelles ils sont sensibles sont également néfastes pour leurs hôtes ; l’arsenal de drogues efficaces contre les protozoaires est donc limité. On peut citer la toxoplasmose, la leishmaniose transmise par des petits diptères hématophages appelés « phlébotomes », la maladie du sommeil (trypanosomiase africaine) transmise par les mouches tsé-tsé (ou glossines), et la maladie de Chagas (trypanosomiase américaine) transmise par des punaises appelées « réduves ». Le paludisme est également dû à un protozoaire ; il serait d’origine zoonotique, mais ne se transmet plus aujourd’hui des animaux aux humains, à l’exception du paludisme à Plasmodium knowlesi et P. cynomolgi en Asie du Sud-Est. Les arthropodes parasites sont essentiellement des insectes et des acariens qui parasitent la peau (parasites externes ou ectoparasites). Ils occasionnent parfois une simple nuisance, mais peuvent aussi provoquer des démangeaisons intenses et entraîner des lésions importantes avec retentissement sur l’état général. Certains, tels que les moustiques et les tiques, jouent en plus le rôle de vecteurs pour des virus, des bactéries et des protozoaires pathogènes. Les substances utilisées pour la lutte contre les arthropodes parasites sont les insecticides et les acaricides. MALADIES NON INFECTIEUSESASSOCIÉES AUX ANIMAUX Les animaux peuvent nous rendre malades en nous « transmettant » d’autres choses que des agents pathogènes. Il ne s’agit donc pas de zoonoses. Les animaux produisent des allergènes auxquels environ3 % de la population française est allergique. C’est le cas de l’allergène contenu dans la salive du chat, que celui-ci dépose sur son pelage. Les chevaux produisent également des allergènes présents dans les poils, les squames et l’urine. Les rongeurs, quant à eux, peuvent provoquer des allergies très virulentes, notamment par le biais des protéines allergisantes émises dans l’urine. Pour ce qui concerne les oiseaux, les allergènes les plus connus sont contenus dans les fientes. Un certain nombre de ces allergènes, très volatils, peuvent être inhalés à distance des animaux. Il existe également les allergies aux arthropodes, suite à leur piqûre, à l’injection de leur venin ou encore à leur inhalation pour ce qui concerne les acariens. Les animaux peuvent aussi nous transférer des gènes portés par des organismes, pathogènes ou non, qu’ils hébergent. C’est le cas lorsque des gènes de résistance à des médicaments se transmettent des humains aux animaux ou vice versa. Les bactéries chez l’humain ou l’animal partagent les mêmes mécanismes de résistance. Plus de soixante ans d’utilisation sans restriction d’antibiotiques ont fortement sélectionné les bactéries pour leur résistance. Ce problème devient très prégnant et demande de diminuer fortement l’usage des antibiotiques chez les animaux et les humains. Aussi l’antibiorésistance est-elle de plus en plus souvent incluse dans la problématique des zoonoses. Les prions sont des protéines dont la conformation ou le repliement est anormal. Elles sont exprimées essentiellement dans le cerveau et la moelle épinière des mammifères adultes. À la différence des virus, bactéries et parasites, le support de leur information infectieuse n’est pas représenté par les acides nucléiques (ADN, ARN). La conformation spatiale anormale, d’une part, les rend insensibles aux enzymes de dégradation et, d’autre part, se transmet aux protéines encore normales, régulièrement synthétisées. Sous l’accumulation des protéines prions, le tissu nerveux prend alors l’apparence d’une éponge. C’est pourquoi les maladies neurodégénératives du système nerveux central chez les humains et les autres mammifères sont appelées « encéphalopathies spongiformes transmissibles ». Les prions sont extrêmement résistants aux procédés classiques d’inactivation et de désinfection, et il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement contre ces maladies. La seule zoonose à prions décrite à ce jour est l’encéphalopathie spongiforme bovine. Les autres sont des maladies à prions propres aux humains (syndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker, ou bien encore lekuru) ou propres à d’autres espèces de mammifères (par exemple la tremblante du mouton). QU’EST-CE QU’UN RÉSERVOIR ? Un réservoir est défini comme un système écologique dans lequel un agent pathogène se maintient de manière pérenne et à partir duquel il se transmet à une population cible d’intérêt, l’humain en l’occurrence pour les zoonoses. La structure d’un réservoir peut être plus ou moins complexe : il peut s’agir d’une population animale constituée d’une seule espèce hôte ou d’une communauté de populations de diverses espèces hôtes, chaque espèce contribuant à des degrés divers à la dynamique de transmission de l’agent pathogène. Le réservoir peut également inclure une partie environnementale. Les hôtes réservoirs sont plus ou moins sensibles à l’infection. Par exemple, seul le renard roux (Vulpes vulpes) était le réservoir du virus de la rage des mammifères non volants en Europe, alors que le réservoir des bactéries responsables de la borréliose de Lyme est constitué par un ensemble de populations d’espèces de rongeurs, d’oiseaux et de tiques dans lesquelles elles circulent. Un autre exemple est celui du parasite protozoaire Cryptosporidium parvum, qui provoque des gastroentérites aiguës chez l’humain et dont le réservoir est composé de nombreuses espèces de mammifères et un environnement souillé par les déjections animales. Le fait qu’une population joue un rôle de réservoir dans un endroit donné dépend de sa « compétence », c’est-à-dire sa capacité maintenir la transmission de l’agent au sein de la population (entre individus de la même espèce) et à d’autres espèces réceptives. Lorsque les agents pathogènes sont transmis par des vecteurs, la compétence peut être estimée par le pourcentage de vecteurs qui s’infectent en se nourrissant sur un animal infecté. Mais le rôle effectif joué dans un environnement donné par une population d’hôtes réservoirs dépend également des conditions épidémiologiques et écologiques : densité de population, fréquence de contacts, communauté d’espèces, conditions environnementales, etc. Par exemple, plusieurs espèces de primates non humains sont des réservoirs des virus du chikungunya ou de la dengue, car ils sont sources d’infection pour les moustiques Aedes sylvestres. Par contre, en milieu urbain ou encore sur l’île de la Réunion, où les primates non humains sont absents (sauf dans le zoo), ils ne jouent pas de rôle épidémiologique. La transmission a alors uniquement lieu entre humains et moustiques, tel Aedes albopictus, sans intervention d’autres primates. La question se pose de savoir si certains groupes taxonomiques sont plus susceptibles d’être réservoirs de zoonoses et, si oui, quelles en sont leurs caractéristiques. Il est établi qu’une forte proximité phylogénétique avec l’espèce humaine favorise l’échange d’agents pathogènes, comme c’est le cas entre les humains et les primates non humains. De même, les espèces qui ont cohabité de longue date avec les humains (animaux domestiques, animaux commensaux) ont eu d’autant plus d’opportunités de partager leurs agents pathogènes. Ainsi, le nombre d’agents pathogènes partagés avec les humains augmente en fonction de l’ancienneté de la domestication des espèces correspondantes. En revanche, le fait que certains groupes taxonomiques, comme les rongeurs ou les chiroptères, puissent être de meilleurs réservoirs en raison de caractéristiques comme leurs traits d’histoire de vie (exemple : nombre de petits, durée de vie), leur écologie (exemple : habitats, individus grégaires ou solitaires, place danse réseau trophique), leur système immunitaire ou leur physiologie, demeure sujet à discussion (voir encadré p. 72). Il semble que le nombre de virus dans les différents ordres de mammifères dépende surtout du nombre d’espèces dans l’ordre, mais aussi des recherches effectuées. Ainsi, l’ordre des rongeurs (qui contient2 552 espèces) et celui des chiroptères (1 386 espèces) hébergent nettement plus de virus que les carnivores (305 espèces). Il semble aussi que la proportion de virus zoonotiques parmi les espèces de virus au sein d’un groupe taxonomique soit assez stable, en dehors des facteurs liés à la proximité phylogénétique (les primates) et à la cohabitation avec les humains (les animaux domestiques). Il est donc logique que les rongeurs et les chiroptères hébergent le plus grand nombre de virus zoonotiques. De plus, il faut garder l’esprit que l’intérêt porté à certains taxons peut les surreprésenter dans les données dont nous disposons. PUIS-JE ME CONTAMINERÀ PARTIR D’UN ANIMAL EN BONNE SANTÉ ? Un agent zoonotique pathogène pour l’humain n’est pas forcément pathogène pour les animaux. En effet, il peut s’agir de flore commensale pour l’animal qui, une fois chez l’humain, se révèle pathogène. Par exemple, une majorité de chats est porteuse de bactéries du genre Pasteurella au niveau des voies aérodigestives supérieures sans présenter le moindre symptôme. Ces bactéries peuvent être inoculées lors de morsures ou de griffures et provoquer des infections locales qui requièrent souvent un traitement antibiotique. Les animaux peuvent également être tolérants vis-à-vis d’agents pathogènes, c’est-à-dire que même infectés ils ne présentent pas de symptômes visibles, ce qui est fréquemment le cas pour les espèces réservoirs de maladies. On peut citer l’exemple des rongeurs et des oiseaux réservoirs de la borréliose de Lyme ou celui des chauves-souris réservoirs de nombreux virus émergents. Cela est fréquent également pour les parasites intestinaux qui peuvent passer inaperçus chez l’animal, comme c’est le cas pour les ascaris infestant les chiens et les chats. En revanche, ingérés par l’être humain, ils vont provoquer des troubles. Enfin, l’animal peut se trouver dans une phase d’incubation de la maladie durant laquelle il est contagieux, mais n’exprime pas encore de symptôme. C’est pour toutes ces raisons qu’il ne faut pas manipuler un animal qu’on ne connaît pas, qui plus est sauvage et dans des conditions d’hygiène inappropriées. Cependant, il ne faut pas non plus voir le danger partout. Lorsque l’animal n’a apparemment pas de symptôme, que vous le connaissez, qu’il jouit de conditions d’hygiène et d’entretien satisfaisantes, le risque de contracter une zoonose est très faible pour un humain ayant un système immunitaire fonctionnant normalement. D’UNE ESPÈCE À UNE AUTRE : SPECTRES, SAUTS, BARRIÈRES, FILTRES ET AUTRES STADES Les interactions entre un agent pathogène et ses hôtes sont considérées comme longues et intimes (on parle même d’interactions « durables » !) en comparaison d’une interaction proie-prédateur. Certains agents pathogènes coévoluent avec leur hôte depuis des millions d’années. Ces interactions les ont conduits à « utiliser » toutes les possibilités de transmission. Ainsi, tout un vocabulaire est déployé pour rendre compte de ce phénomène. Le « spectre d’hôtes » représente l’ensemble des espèces susceptibles d’être infectées par un agent pathogène donné. Ainsi les agents pathogènes pouvant infecter plusieurs espèces d’hôtes sont dits « large spectre », ceux infectant un nombre d’espèces restreint sont dits à « faible spectre ». Ces derniers sont favorisés dan les milieux à fortes densités de populations d’un nombre limité d’espèces. Cela leur permet d’« exploiter » moins d’espèces mais de façon plus efficace. Ceux à large spectre, plutôt généralistes, sont moins dépendants d’une seule ressource. Cependant, les avancées en génomique permettent de mieux caractériser la diversité intraspécifique des agents pathogènes et ont permis de montrer dans certains cas l’existence de différentes souches à l’intérieur d’une même espèce d’agents pathogènes, souches qui peuvent être elles-mêmes adaptées à différentes espèces animales. On parle de « saut d’espèces » pour évoquer le passage d’un agent pathogène d’une espèce hôte à une autre. Cette expression est surtout employée lorsque le passage nous paraît nouveau ou qu’il surprend les épidémiologistes, qui parfois usent de l’expression bien impropre de « franchissement de la barrière d’espèce » ! Il est très difficile de quantifier la fréquence de ces « sauts ». Dans les schémas de transmission d’agents pathogènes, à côté des exemples de passages réussis et connus, combien y a-t-il d’échecs ou de passages sans impact sanitaire, par définition non documentés ? La vie est un tissu de relations mélangeant à la fois des phénomènes continus et discrets. Prenons l’exemple de la vache folle à propos de la transmission par ingestion de viande contaminée au Royaume-Uni. Le cas des carnivores touchés est assez démonstratif. Ainsi, seuls des félidés, en particulier des chats domestiques, ont exprimé la maladie, et aucun chien, ni même aucun canidé n’a manifesté de symptômes, alors qu’ils ont probablement été soumis à la même exposition que les chats. Un exemple de saut d’espèces dans un périmètre zoologique plus restreint concerne l’histoire des Plasmodium connus chez les humains et quelques autres primates. Les Plasmodium sont les agents du paludisme transmis par les moustiques, maladie également appelée « malaria ». Jusqu’à présent, on associe quatre espèces à H. sapiens, à savoir P. falciparum, P. malariae,P. ovale et P. vivax. L’histoire de P. falciparum, le plus agressif des quatre, intrigue toujours. L’adaptation à l’espèce humaine semble imparfaite tant la pathologie associée à ce parasite est encore élevée. Des études de phylogénie parasitaire des années 2010 suggèrent que P. falciparum serait le descendant d’un parasite de gorille (Gorilla gorilla) transmis aux humains relativement récemment. Le parasite encore présent chez les gorilles n’est plus un agent de zoonose, mais il est l’origine d’une espèce de Plasmodium devenue humaine. Parallèlement, toujours depuis les années 2010, on décrit une nouvelle espèce de parasite chez des malades en Asie tropicale,P. knowlesi, déjà connu de macaques locaux. Serait-ce un saut d’espèces, une adaptation récente de ce parasite à un nouvel hôte ? Il semble plutôt que cela corresponde au remplacement de tests diagnostiques utilisant la microscopie optique par des tests génétiques. On réalise depuis que, morphologiquement, P. knowlesi a été régulièrement confondu avec P. malariae du fait de leur ressemblance morphologique. Il ne semble d’ailleurs pas exister de transmission interhumaine de ce parasite de macaque. Il en est de même d’un autre plasmodium de singe, P. cynomolgi, morphologiquement ressemblant à P. vivax. Finalement, P. knowlesi et P. cynomolgi restent des parasites de macaques à potentiel zoonotique. Rien n’indique que ces deux parasites soient en passe de « s’humaniser ». On évoque régulièrement la notion de « barrière d’espèce » en référence à la notion de « saut d’espèces », et tout particulièrement à propos de l’étude des zoonoses émergentes. La barrière d’espèce serait une limite à la faculté de transmission d’un agent pathogène d’une espèce à une autre jusqu’alors non affectée. Cette barrière protégerait en particulier les humains. Mais cette expression est, de fait, assez antinomique avec celle de zoonose. Toutes les zoonoses et les maladies multi-hôtes en général démontrent que la barrière d’espèce se franchit, s’enjambe, se contourne. Reste que pour pouvoir infecter différentes espèces, un agent pathogène doit traverser plusieurs processus que le parasitologue Claude Combes a nommés « filtres ». Le filtre de rencontre représente l’éventualité de rencontre entre l’agent pathogène et l’espèce hôte. Il dépend de l’écologie et des comportements des espèces impliquées. Par exemple, la petite douve du foie (Dicrocoelium dendriticum) est un ver plat (plathelminthe) qui a besoin pour son développement de trois hôtes, un escargot, une fourmi et un ruminant. C’est une parasitose fréquente chez les animaux, mais rare chez l’humain, car elle nécessite l’ingestion, même involontaire, d’une fourmi parasitée. Néanmoins, il y eau des contaminations humaines par d’autres vers parasites chez des personnes qui avaient parié d’avaler une limace ! Ce pari était peut-être inspiré des traitements contre la tuberculose dans les sanatoriums au XIXe siècle qui incluaient l’ingestion de limaces ! Le deuxième filtre est celui de compatibilité. Il représente la faculté pour l’agent pathogène de s’établir et de se multiplier ou se reproduire chez l’hôte en contournant ses mécanismes de défense. L’interaction de l’agent pathogène avec son hôte peut engendrer des comportements qui favorisent la transmission. Par exemple, la petite douve du foie modifie le comportement des fourmis qui restent figées en haut des herbes et se font plus facilement manger par les ruminants. C’est aussi le cas de l’agent de la toxoplasmose (Toxoplasma gondii), qui inhibe la peur des souris infectées vis-à-vis du chat, ce qui permet aux chats de les capturer plus facilement. Le passage d’une espèce à une autre implique ainsi des processus la fois écologiques (qui agissent sur la probabilité de contact entre l’agent pathogène et le nouvel hôte), cellulaires et moléculaires (qui agissent sur les interactions entre la machinerie de l’hôte excelle de l’agent pathogène) et enfin évolutifs (qui agissent sur la diversité génétique et les processus d’adaptation). Les maladies animales et zoonotiques peuvent être classées en stades suivant l’importance que prend la source animale dans la transmission aux humains (voir tableau 1). Cette classification est bien sûr arbitraire, et les frontières entre les stades sont perméables, mais elle est utile pour distinguer les différentes situations épidémiologiques au regard de la compréhension des schémas de transmission, de l’interaction hôtes-pathogènes et de la prévention et du contrôle de la maladie. Le stade 1 est celui où l’agent pathogène ne se transmet pas aux humains, il ne concerne que l’animal. La maladie n’est donc pas une zoonose, mais une maladie animale stricte. Le stade 2 correspond à la situation où les humains se contaminent uniquement à partir de l’animal. Il n’y a aucune transmission interhumaine. Au stade 3, les humains se contaminent essentiellement à partir de l’animal, mais il peut y avoir quelques transmissions interhumaines. L’agent pathogène n’est pas encore bien adapté à cette transmission. Par contre, au stade 4, l’essentiel des cas humains est dû à une transmission interhumaine, mais l’agent pathogène chez l’animales toujours source d’infection pour les humains dans certaines circonstances. Enfin, au stade 5, l’infection chez les humains est uniquement due à une transmission interhumaine, mais l’agent pathogène provient originellement des animaux. Ces maladies ne sont donc plus des zoonoses à proprement parler, mais elles sont d’origine zoonotique. Où se situe la Covid-19 ? Le virus est d’origine animale. Après un très probable passage animal-humain, le virus s’est adapté aux humains, chez lesquels il s’est mis à circuler sans qu’intervienne de transmission à partir d’un animal. On peut donc raisonnablement la considérer au stade 5, même si de rares contaminations d’animaux de compagnie (chats et chiens) ont été décrites en espace clos (appartements) à partir d’humains malades et excréteurs. De même, le passage à des individus d’espèces sauvages captives (félins en zoo et visons en élevage) est observé. Des contaminations en retour d’humains travaillant dans des élevages de visons ont par ailleurs été décrites, mais cette contamination, qui reste exceptionnelle, est due à la très forte pression d’exposition aérienne dans des bâtiments rassemblant plusieurs milliers d’animaux.