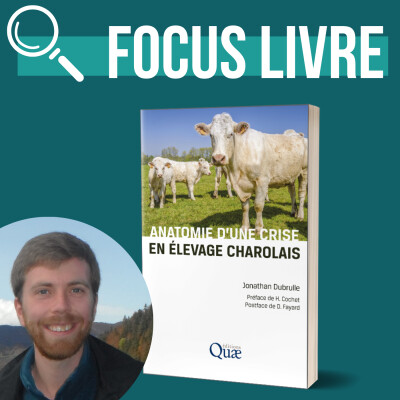Speaker #1Que savez-vous des zoonoses, ces maladies transmissibles entre les humains et les animaux ? Dans cette série d'épisodes, les éditions Quae vous proposent un éclairage sur ce sujet d'actualité. Que sont les zoonoses ? Quels animaux peuvent les transmettre ? Parmi elles, quelles sont les zoonoses virales ?
LES PRINCIPALES ZOONOSES PAR GROUPE TAXONOMIQUE D’HÔTES
Nous abordons ici divers exemples d’agents zoonotiques transmis aux humains par des animaux proches sur un plan phylogénétique (primates) ou comportemental (animaux domestiques et commensaux), ou avec lesquels les interactions augmentent du fait de la destruction des habitats naturels (chauves-souris).
Les primates non humains
Les primates représentent un ordre avec 518 espèces reconnues en 2018. Actuellement, les primates non humains sont répartis pour l’essentiel dans les zones intertropicales de la planète. Surtout arboricoles et frugivores, mais les exceptions sont nombreuses, ils disparaissent au rythme de la déforestation. Pratiquement toutes les espèces sont protégées dans leur pays d’origine. Comme les primates non humains indigènes ne sont présents ni en France métropolitaine ni en Europe (les magots, Macaca sylvanus, présents à l’état sauvage à Gibraltar, ont été introduits), les contacts potentiels avec ces espèces résultent d’animaux de laboratoires de recherche et d’expérimentation, d’animaux de parcs zoologiques et de tous les établissements de présentation au public, ou d’animaux présents chez des particuliers, le plus souvent introduits et détenus illégalement. Des textes européens conditionnent leur entrée sur le territoire communautaire à des garanties sanitaires, mais ces textes sont encore en-deçà des risques connus. La diversité au sein de l’ordre des primates est assez grande, depuis les plus petits microcèbes malgaches (Microcebus spp.) ou les ouistitis sud-américains (Callithrix spp.), jusqu’aux gorilles africains (Gorilla spp.). L’ordre des primates ne comprend pas que des singes. Il est divisé en deux sous-ordres, les Strepsirrhiniens (lémurs et loris) et les Haplorrhiniens (tarsiers et singes). Les singes (infra-ordre des Simiiformes) sont eux-mêmes séparés en deux grands groupes : les singes du Nouveau Monde, avec les narinesécartées, et les singes de l’Ancien Monde, aux narines rapprochées. L’espèce humaine appartient à cette dernière catégorie, avec la famille des cercopithécidés : macaques (Macaca spp.), entelles (Semnopithecus spp.) et cercopithèques (Cercopithecus spp.), et la famille des hylobatidés (gibbons). H. sapiens est associé aux gorilles, chimpanzés (Pan spp.) et orangs-outans (Pongo spp.) dans la famille des hominidés. Les espèces et les risques vis-à-vis des zoonoses ne seront pas les mêmes selon qu’il s’agira d’animaux dans leur environnement naturel, destinés à la recherche, aux parcs zoologiques ou ceux détenus par des particuliers. Dans le cas des laboratoires de recherche, les espèces introduites sont peu nombreuses (surtout des macaques asiatiques) et sont en général d’origine et de statut sanitaire relativement bien connus car déjà élevés en captivité. En effectif, ils représentent les plus nombreux des animaux de laboratoire importés, avec quelque 2 000 ou 3 000 individus importés par an en France. Les établissements de présentation au public importent très peu d’animaux par an, mais les espèces peuvent être très variées. Les garanties sanitaires doivent également être d’un bon niveau. Dans le cas des particuliers, on peut juste dire que l’on ne sait pas grand-chose et que les garanties sanitaires n’existent probablement pas. Les maladies virales sont sans doute celles qui inquiètent le plus. La rage figure parmi les plus classiques. Ainsi, à la fin des années 1980, un trafic de magots (Macaca sylvanus) depuis l’Algérie vers la région lyonnaise s’était traduit par plusieurs cas de rage induits par la vaccination. Les petits singes étaient vaccinés, avant leur sortie d’Algérie, à l’aide d’un vaccin vivant atténué non adapté à l’espèce et interdit en France. Heureusement, aucun cas de transmission à l’humain ne fut déploré. Une autre maladie qui fait peur est l’infection due à l’herpès virus simien, ou virus B simien. Même si, mondialement, le nombre de cas humains connus reste faible, quelques dizaines, le taux de létalité est, lui, élevé : 80 %. Le virus est lié aux macaques asiatiques, c’est-à-dire toutes les espèces du genre Macaca, sauf le magot d’Afrique du Nord. Il faut aussi savoir que les macaques M. fascicularis de l’île Maurice, introduits au xvie ou au xviie siècle sur l’île depuis l’Asie du Sud-Est, sont également indemnes, alors que le taux de séropositivité des populations sauvages asiatiques varie de 70 à 100 %. Les primates jouent également un rôle dans les cycles sylvatiques des arbovirus comme le chikungunya, la dengue et le Zika. Les fièvres hémorragiques représentent l’autre grand groupe de virus inquiétants des primates non humains. Selon les cas, ils sont réservoirs (maladie du singe vert africain et fièvre jaune) ou victimes (Ebola en Afrique et Ebola Reston en Asie). Alors que toutes les populations des espèces de primates non humains déclinent, nous découvrons leur rôle dans l’épidémiologie de différents virus, bactéries et parasites potentiellement sévères. Dans beaucoup de situations (Ebola, mycobactérioses…), cependant, les espèces de primates non humains sont d’abord les victimes de ces épizooties.
Les chats et les chiens
Les chats et les chiens sont deux espèces de la famille des félidés et des canidés respectivement, appartenant à l’ordre des carnivores, qui comprend quelque 300 espèces. Ils partagent nos vies depuis au moins 9 000 ans pour les chats et au moins 15 000 ans pour les chiens. Ils peuvent nous transmettre des maladies, essentiellement par le biais des excréments et du pelage, à l’occasion de morsures ou de griffures, par l’intermédiaire d’arthropodes vecteurs ou dans des situations particulières telles que la mise bas ou la présence d’une plaie. Cependant, des règles d’hygiène de base ainsi qu’un bon suivi de l’état de santé de son animal de compagnie permettent en général de limiter les risques de transmission de maladie. Les excréments représentent la principale source de contamination pour l’humain. Ils peuvent contenir des œufs d’helminthes (les « vers »), des protozoaires et des bactéries. Parmi les helminthes, on trouve des vers ronds (ascaris et ankylostomes) et des vers plats (ténias et échinocoques) qui vivent dans l’intestin de leurs hôtes naturels, le chien et le chat. Ingérés par l’humain, les œufs ou les larves de ces parasites peuvent migrer dans divers organes et provoquer des symptômes plus ou moins graves. Les enfants sont particulièrement à risque de contracter ces parasites parce qu’ils jouent beaucoup sur le sol, « mettent tout à la bouche » et ont des contacts étroits avec les animaux lorsqu’ils leur font des câlins. Une vermifugation régulière des chiens et chats permet de limiter les risques de transmission « domestique ». Le chat est également l’hôte naturel du protozoaire responsable de la toxoplasmose, à laquelle les femmes enceintes doivent être vigilantes. Outre le risque de transmission d’agents pathogènes liés aux excréments qui auraient contaminé le pelage, le contact avec la peau ou le pelage des chiens et des chats ne représente pas de danger particulier si les animaux sont en bonne santé et sont régulièrement traités avec des antiparasitaires externes. En revanche, gare aux animaux qui se grattent beaucoup ou perdent leurs poils : ils ont peut-être des puces, ou sont porteurs de la teigne, de la gale. De même, un animal dont les yeux ou le nez coulent peut être porteur de bactéries susceptibles de donner chez l’humain des symptômes de conjonctivite. Dans toutes ces situations, une visite chez le vétérinaire permettra de poser un diagnostic et de savoir s’il existe ou non un risque de transmission à l’humain. Il convient également d’être très vigilant aux risques liés aux morsures et aux griffures. Les chiens et les chats peuvent se faire piquer par des arthropodes vecteurs et jouer le rôle de réservoir pour un certain nombre d’agents pathogènes. Par exemple, les phlébotomes, présents sur le pourtour méditerranéen, peuvent transmettre Leishmania infantum, un protozoaire responsable de la leishmaniose chez le chien. Ce parasite pose problème essentiellement aux enfants et aux personnes immunodéprimées, chez lesquelles il provoque des affections cutanées ou viscérales très invalidantes, voire mortelles si elles ne sont pas traitées. Normalement, les chiens ne transmettent pas leurs tiques directement à l’humain : ils les contractent, comme l’humain, à partir de la végétation sur laquelle les tiques sont à l’affût.
Les bovins, les ovins et les caprin
Les bovins, les ovins et les caprins appartiennent à des sous-familles de la famille des bovidés appartenant à l’ordre des cétartiodactyles, qui comprend quelque 550 espèces et dont la principale particularité est de posséder un nombre pair de doigts. Les bovins comprennent plusieurs espèces importantes d’élevage, en particulier les vaches (Bos taurus) ou les zébus (Bos indicus) ainsi que les yaks (Bos grunniens) et les buffles (genre Bubalus). Les ovins comprennent les moutons (Ovis aries) ainsi que les mouflons sauvages (Ovis spp.), tandis que les caprins comprennent les chèvres (Capra hircus) ainsi que le bouquetin des Alpes (Capra ibex) par exemple. Les bovins domestiques actuels descendent des aurochs (B. primigenius), aujourd’hui disparus, domestiqués il y a 10 500 ans au moins en deux endroits distincts. La domestication des chèvres remonte à 10 000 ans av. J.-C. en Iran, et celle des moutons à 8 500 ans av. J.-C. au Moyen-Orient et en Inde. Actuellement, les bovins domestiques sont environ 1,5 milliard dans le monde. Les bovins, les ovins et les caprins sont des ruminants. Leur appareil digestif a la particularité de posséder plusieurs compartiments qui leur permettent de digérer en remastiquant les aliments après leur ingestion. Les aliments sont ensuite régurgités pour être mélangés avec de la salive, mastiqués à nouveau puis ingérés. Les ruminants domestiques fournissent aux humains de vastes quantités de viande, des produits laitiers, du cuir et du fumier comme engrais. Ils apportent également des services environnementaux, comme le maintien des prairies et des paysages ouverts, ainsi que leur force de travail dans certains contextes. Parmi les maladies se transmettant des bovins à l’humain, les grandes campagnes de prophylaxie chez l’animal ont permis de nettement limiter la transmission de zoonoses historiquement majeures, comme la tuberculose bovine due à Mycobacterium bovis et la brucellose due à des bactéries du genre Brucella, même s’il est compliqué d’éradiquer totalement ces maladies. Des exemples de zoonoses alimentaires associées à la consommation de viande bovine sont les intoxinations dues aux EHEC et l’encéphalopathie spongiforme bovine, pour laquelle le risque est aujourd’hui maîtrisé. Les personnes les plus exposées aux zoonoses transmises par les ruminants domestiques sont celles qui travaillent quotidiennement avec eux, tels les éleveurs, les vétérinaires, les travailleurs en abattoirs. La transmission peut se faire lors d’un contact avec la peau, la carcasse ou les muqueuses, ou lors de l’inhalation de poussières ou d’air contaminés. La mise bas et la survenue d’avortements constituent des situations particulièrement à risque, car diverses bactéries zoonotiques peuvent être transmises au contact du placenta, comme dans le cas de la fièvre. C’est pourquoi, dans les élevages pratiquant l’accueil du public, il est recommandé d’isoler les femelles qui mettent bas dans un local spécifique interdit d’accès aux visiteurs ou de limiter les visites pendant les périodes de mise bas.
Les porcs et les sangliers
Le porc (Sus domesticus) est la forme domestique du sanglier (Sus scrofa). Tous deux appartiennent à la famille des suidés, de l’ordre des cétartiodactyles comme les bovins. Le porc a été domestiqué dans au moins deux foyers indépendants. L’un au nord de la Mésopotamie (en Irak actuel) vers 7 500 ans av. J.-C., l’autre en Chine 6 000 ans av. J.-C. Porcs et sangliers sont très proches phylogénétiquement, au point qu’ils peuvent se reproduire entre eux. Du fait de cette proximité, ils présentent une certaine homogénéité dans les risques sanitaires associés. Dans le cas du porc domestique, l’évolution des pratiques d’élevage a certainement considérablement modifié les risques pour la santé publique. Ces risques ne sont pas les mêmes entre les fermes traditionnelles, avec parfois encore des parcours extérieurs en Europe, et les grands ateliers industriels hors-sol, sans oublier les porcs de compagnie dont la présence se développe. Diverses zoonoses, d’origine virale, bactérienne ou parasitaire, sont associées aux suidés. Le virus de l’hépatite E (famille des hepeviridés, genre Orthohepevirus) est zoonotique, mais son cycle semble combiner plusieurs cheminements possibles. La contamination peut se faire par consommation de viande porcine, mais probablement aussi par contact direct avec des animaux vivants, voire par de l’eau contaminée. Le porc n’est pas le seul réservoir. Les Influenzavirus circulent volontiers chez les porcs domestiques. Le schéma épidémiologique associant anatidés domestiques, élevages de porcs et humains est souvent présenté comme potentiellement à risque. Si, comme en Asie, des canards sauvages peuvent croiser leurs congénères domestiques qui ont accès à des parcours extérieurs et qui à leur tour peuvent entrer en contact avec des porcs, les épidémiologistes considèrent que des recombinaisons virales pouvant déboucher sur des virus zoonotiques pourraient émerger. Si la brucellose porcine à Brucella suis a pratiquement disparu des élevages industriels, elle est toujours présente chez les sangliers. Le développement des élevages de porcs en plein air pour des raisons de bien-être animal à la fin du xxe siècle a eu une conséquence imprévue en termes sanitaires. En effet, les grillages de ces élevages empêchent bien les truies de sortir, mais ils n’empêchent pas toujours les sangliers mâles de visiter les parcelles. Les éleveurs ont obtenu des portées mi-porcelets, mi-marcassins et récupéré chez leurs animaux la brucellose porcine. Des cas de contaminations humaines directes en manipulant des carcasses de sangliers ont été décrits, mais semblent rares. Pour information, des souches spécifiques de B. suis circulent indépendamment chez les lièvres européens (Lepus europaeus). Le porc domestique et le sanglier peuvent héberger deux vers parasites, le ver solitaire, cestode, et la trichine, nématode. Le ténia Taenia solium est le véritable « ver solitaire », présent sous forme adulte, mature et reproductive dans l’intestin humain, et sous forme du cysticerque contaminant, la larve, chez le porcin. Il s’agit d’un parasite dont la présence chez l’hôte représente un coût sanitaire réel. Des programmes de lutte à l’échelle de communautés, de régions, de pays, montrent qu’en combinant les traitements chez les humains avec ceux chez les porcs, associés au respect de règles d’hygiène appropriées, on arrive à éliminer le cycle de transmission du parasite. Des résultats intéressants ont ainsi été obtenus dans des pays aussi différents que le Pérou et la Zambie.
Les chevaux
Les chevaux (Equus caballus) font partie de la famille des équidés de l’ordre des périssodactyles, qui comprend 21 espèces et dont les espèces ont la particularité d’avoir un nombre impair de doigts aux membres postérieurs. Cet ordre comprend trois familles : les équidés (chevaux, ânes Equus asinus et spp., zèbres Equus grevyi et spp.), qui possèdent un seul doigt visible aux quatre membres, les tapiridés, qui possèdent trois doigts aux postérieurs et quatre aux antérieurs, et les rhinocérotidés, avec trois doigts aux quatre membres. C’est aux alentours de 4 500 ans av. J.-C., après les bovins, que l’humain a domestiqué le cheval dans les steppes eurasiennes. Les principales zoonoses provenant des équidés sont liées à des contacts cutanés avec les animaux infectés par la teigne ou la gale ou liées à un manque d’hygiène dans la manipulation du crottin. Les maladies les plus graves sont désormais très rares, voire absentes en France grâce aux mesures de lutte mises en place. On peut mentionner la pseudotuberculose (Yersinia pseudotuberculosis), le charbon bactéridien (B. anthracis) et la morve (Burkholderia mallei), affection qui a quasiment disparu. Ces deux dernières bactéries sont considérées comme des agents de bioterrorisme du fait de la faible dose infectante et de la possibilité d’infection par aérosol. On peut également mentionner le rôle des chevaux dans l’émergence du virus Hendra en Australie. Enfin, les chevaux peuvent être atteints par des arborivus responsables d’encéphalomyélites virales, notamment l’infection à virus West Nile dans le bassin méditerranéen, l’encéphalite japonaise en Asie et en Océanie, ou les encéphalomyélites équines américaines sur le continent américain. Selon le type de virus, des espèces d’oiseaux ou de rongeurs sont réservoirs. Le cheval est un cul-de-sac épidémiologique, c’est-à-dire qu’il ne retransmet pas le virus au moustique vecteur. Les chevaux ne sont donc pas sources de contamination, mais peuvent jouer le rôle de sentinelle indiquant que le virus circule dans la zone. Enfin, on associe le cheval au risque de tétanos, car l’espèce est extrêmement sensible à cette maladie.
Les rongeurs
Les rongeurs représentent l’ordre de mammifères ayant le plus grand nombre d’espèces, devant les chiroptères et loin devant tous les autres ordres. Pour un total de 6 495 espèces de mammifères recensées en 2018, les rongeurs en comptent 2 552, soit 39 %. Les chiffres et les pourcentages peuvent évidemment varier un peu avec les sources, mais par un simple effet de nombre, la biodiversité spécifique des rongeurs peut offrir une plus grande diversité d’agents pathogènes que les autres ordres. Il n’est donc pas possible de prétendre être exhaustif, mais voici quelques grandes entités particulièrement importantes en santé publique. En ce qui concerne les maladies virales, les plus notables pour la santé humaine sont les hantaviridés, les poxviridés (Monkeypox et Cowpox, genre Orthopoxvirus) et les arénaviridés. Les hantaviridés sont responsables de fièvres hémorragiques à syndrome rénal dans l’Ancien Monde et aussi de maladies respiratoires dans le Nouveau Monde, où leur découverte est beaucoup plus récente puisqu’elle date des années 1990. De nombreuses espèces de rongeurs hébergent des souches virales dans le monde, avec une évolution relativement parallèle entre hôtes et virus. Chaque couple hôte-souche est lié à une répartition géographique assez précise. Inversement, la souche Séoul, liée au rat surmulot (Rattus norvegicus), devenu cosmopolite, est largement distribuée sur la planète, en particulier dans les grandes villes où le rat est bien présent. Les situations à risque pour la santé publique correspondent soit à des expositions humaines en zones rurales ou en voie de déforestation, soit à des pullulations localisées de ces espèces qui envahissent alors les territoires humains (maisons, villages), devenant temporairement commensales. En Europe, la souche Puumala est associée au campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus). En France, la maladie est connue dans le massif des Ardennes, à la frontière belge. La famille des poxviridés est représentée chez de nombreuses espèces de vertébrés. Ces virus sont en particulier bien connus chez les mammifères. La variole, éradiquée grâce à la vaccination à la fin du xxe siècle, est l’exemple propre à l’espèce humaine. Mais il existe de nombreux autres virus de la même famille, particulièrement chez les rongeurs, même si le nom donné à ces virus ne l’indique pas. Le virus Cowpox est connu chez des rongeurs champêtres européens et le virus Monkeypox est présent chez des espèces africaines. Ce dernier virus est suivi par l’OMS. En effet, les jeunes générations n’étant plus vaccinées contre la variole, les épidémiologistes se demandent si la niche écologique laissée vacante ne pourrait pas être occupée par d’autres poxviridés, le virus du Monkeypox tout particulièrement. La famille des arénaviridés est probablement moins connue. Le virus responsable de la fièvre de Lassa et celui de la chorioméningite lymphocytaire en sont deux exemples. Les contaminations de l’humain par ce dernier virus sont liées aux hamsters et aux souris de compagnie et peuvent avoir de graves conséquences pour les foetus chez les femmes enceintes. Le virus de Lassa circule en Afrique de l’Ouest, en particulier au Nigeria, où depuis des années les cas comme les décès sont toujours trop nombreux. Le virus est hébergé par des muridés du genre Mastomys (rats à mamelles multiples). Ces rongeurs ne sont pas habituellement anthropophiles, mais selon leurs cycles de populations ils peuvent se rapprocher des habitations et des greniers à grains, ce qui augmente les risques de transmission vers les humains. Concernant les bactéries, la peste à Y. pestis, les leptospiroses et la brucellose à Brucella suis sont trois exemples classiques. Les leptospires sont hébergées dans le système urinaire de nombreuses espèces de rongeurs. Ces derniers éliminent les bactéries avec leurs urines. Les espèces amphibies, comme les rats surmulots, les rats musqués (Ondatra zibethicus) et les ragondins (Myocastor coypus), toutes introduites en Europe, peuvent donc souiller et contaminer les plans d’eau, rivières, canaux, zones humides qu’elles habitent. Les leptospires ne passent pas une peau saine, mais peuvent franchir une peau écorchée ou ayant séjourné longtemps dans l’eau. C’est ce qui les rend dangereuses dans certaines cultures comme le riz ou la canne à sucre dans les départements ultramarins, où les personnes sont parfois mal équipées. En métropole, la maladie est reconnue « professionnelle » pour les égoutiers. Elle voit son incidence annuelle remonter depuis 2014 sans que la cause en soit élucidée.
Les chauves-souris
Avec 1 386 espèces connues à ce jour, soit 21 % des espèces de mammifères, l’ordre des chiroptères, qui regroupe l’ensemble des chauves-souris, constitue le deuxième ordre en nombre d’espèces après celui des rongeurs. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) estimait en 2019 que 15 % d’entre elles étaient menacées de disparition. Comme pour les rongeurs, cette diversité explique en partie qu’elles hébergent une si large gamme d’agents pathogènes. Elles sont présentes sur tous les continents, sauf l’Antarctique. Elles ont développé l’écholocation, un système sonar : les échos de leurs cris renvoyés à leurs oreilles leur indiquent la position des éléments de leur entourage. En Europe, les chauves-souris sont très petites (de 5 à 45 g) et exclusivement insectivores. En Asie et en Océanie, on trouve aussi les Pteropus (appelées aussi roussettes ou renards volants) qui sont frugivores sont frugivores et parmi les plus grandes du monde. Elles peuvent atteindre 1 kg et plus de 1,20 m d’envergure et ne disposent pas de sonar. D’autres espèces de la famille des ptéropodidés habitent l’Afrique, mais elles sont absentes d’Amérique. Elles peuvent parcourir plusieurs milliers de kilomètres. L’Amérique tropicale est la seule région du monde à héberger des espèces hématophages, les trois espèces de chauves-souris vampires. Comme tous les animaux sauvages, elles sont porteuses de nombreuses espèces de bactéries entéropathogènes. Elles sont aussi infectées par des champignons microscopiques (notamment du genre Histoplasma) présents dans leur guano et susceptibles d’être transmis à l’humain par voie aérienne, par exemple lors de la visite d’une grotte, et pouvant entraîner des problèmes respiratoires chez les personnes non protégées ou immunodéprimées. Les chauves-souris sont aussi connues pour être un réservoir de plusieurs virus de la rage (genre Lyssavirus) qui sont différents de ceux qui provoquent la rage du chien et du renard. Mais la maladie humaine est la même : elle est mortelle si un traitement n’est pas mis en place rapidement. La contamination peut se faire par morsure, griffure ou léchage. Les chauves-souris enragées peuvent avoir un comportement modifié, comme se laisser approcher ou avoir des difficultés à voler. Par conséquent, il est très important de ne pas toucher une chauve-souris blessée, au comportement étrange ou morte. Le mieux est de contacter des personnes spécialisées, telles que des chiroptérologues ou des vétérinaires, qui pourront établir un diagnostic. Le virus de la Covid-19 (SARS-CoV-2) est venu s’ajouter à la liste des virus émergents dont les chauves-souris sont les réservoirs potentiels ou avérés. C’est aussi le cas du virus Hendra, décrit pour la première fois en 1994 en Australie suite à la mort de chevaux et de leur soigneur, tous atteints brutalement d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Les chevaux avaient contracté l’infection à partir de fruits souillés par l’urine et la salive de Pteropus infectés et avaient ensuite contaminé le soigneur. Les Pteropus sont aussi impliqués dans la transmission du virus Nipah, pour lequel le taux de létalité varie entre 40 % et 75 % chez les humains. La première épidémie remonte à la fin des années 1990 en Malaisie, où la déforestation pour des plantations de palmiers à huile a entraîné la destruction de l’habitat des chauves-souris. Elles ont trouvé de la nourriture dans les fermes de porcs où étaient plantés des arbres fruitiers et ont ainsi contaminé les porcs qui, à leur tour, ont contaminé les humains. Depuis, des épidémies ont lieu régulièrement en Inde et au Bengladesh, avec une contamination humaine directe par ingestion de sirop de palme ou de fruits contaminés. De même, des chauves-souris frugivores sont suspectées d’être le réservoir sauvage des filovirus, responsables des fièvres hémorragiques Marburg et Ebola en Afrique, même si la question n’est pas encore totalement élucidée. Enfin, des chauves-souris insectivores (genre Rhinolophus ou Taphozous) sont suspectées de jouer un rôle dans l’émergence des coronavirus SRAS-CoV-1, SRAS-CoV-2 et MERS.
Les oiseaux
La classe des oiseaux comprend plus d’espèces que celle des mammifères, avec quelque 11 500 espèces, dont la moitié de l’ordre des passériformes (passereaux). Nous sommes donc encore loin de connaître l’ensemble des agents potentiellement pathogènes qu’ils hébergent. Les oiseaux sauvages partagent – aujourd’hui – avec les humains la particularité de pouvoir se déplacer rapidement sur de grandes distances. Chaque année, en période de migration, des milliards d’oiseaux transitent d’un continent à l’autre pour rejoindre, selon la saison, leur site d’hivernage ou de nidification. Au cours de ces déplacements, les oiseaux migrateurs véhiculent avec eux tout un panel de parasites, bactéries et virus, dont certains sont potentiellement pathogènes pour l’humain, chez lequel ils provoquent trois types principaux de symptômes : digestifs, respiratoires et/ou cutanéo-muqueux, et nerveux. Ils sont probablement à l’origine de la très large répartition de nombreux agents pathogènes. Sur une échelle de temps plus courte, ce transport par les oiseaux peut entraîner l’introduction ponctuelle d’agents pathogènes dans des zones jusqu’alors indemnes et conduire à l’émergence de maladies nouvelles pour les populations locales. Les fientes d’oiseaux contiennent des agents responsables de gastro-entérites, par exemple des bactéries des genres Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Escherichia coli ou des parasites du genre Giardia. Les espèces qui partagent leur habitat avec les humains, en particulier les mouettes et les goélands qui fréquentent les décharges ou les stations d’épuration, sont particulièrement exposées aux bactéries résistantes aux antibiotiques présentes dans les déchets et peuvent contribuer à les disséminer dans l’environnement. Les fientes d’oiseaux peuvent aussi être une source d’infection par une bactérie intracellulaire, Chlamydia psittaci, agent de la psittacose chez l’humain, une maladie qui se traduit par un syndrome pseudo-grippal pouvant évoluer en infection pulmonaire sévère. Les oiseaux sont porteurs sains, notamment les palmipèdes. Le personnel des élevages clos de volailles et des abattoirs de canards est particulièrement exposé. La population mondiale de poules (Gallus gallus) était estimée à plus de 22 milliards en 2017 par la FAO ! Les virus les plus à craindre chez les oiseaux domestiques, car pouvant avoir un impact en santé publique, sont certainement les Influenzavirus, responsables de la grippe. Par contre, contrairement aux idées évoquées parfois dans les médias, la transmission de virus de la grippe des oiseaux sauvages aux humains est extrêmement rare. En effet, bien que les oiseaux hébergent fréquemment des virus grippaux et les excrètent dans leurs fientes, il s’agit de virus aviaires non transmissibles à l’humain ou, éventuellement, susceptibles de n’entraîner qu’une conjonctivite. Le virus A(H5N1) hautement pathogène, apparu chez les volailles domestiques en 2003, constitue une exception puisqu’il est fortement pathogène à la fois pour l’humain et pour les oiseaux sauvages. Les oiseaux sauvages sont les réservoirs de virus et de bactéries zoonotiques transmis par des arthropodes vecteurs comme les bactéries, causant la borréliose de Lyme transmise par les tiques, ou divers arbovirus responsables d’encéphalites chez l’humain et les équidés transmis par les moustiques (infection à virus West Nile, encéphalite de Saint-Louis, encéphalite japonaise, encéphalite équine de l’Est et de l’Ouest, etc.). En Europe, seul le virus West Nile est présent. Est également présent le virus Usutu, d’origine africaine, qui touche principalement les espèces de passereaux. Il n’est que rarement et sporadiquement transmis à l’humain, mais a été la cause de plusieurs épisodes de mortalité massive de passereaux, en particulier de merle noir (Turdus merula) depuis le milieu des années 2010. Les oiseaux sont porteurs de champignons microscopiques (appartenant notamment aux genres Cryptococcus, Histoplasma, Candida, Aspergillus) dans leur plumage, leur bec ou leur tube digestif. Ces champignons peuvent provoquer des infections respiratoires ou cutanees chez l’humain, surtout chez les enfants en bas age, les personnes agees ainsi que les personnes immunodeprimees (notamment atteintes du VIH ou sous chimiotherapie en raison d’un cancer). Enfin, malgre leur nom, les oiseaux ne representent pas les seules sources de contamination des bacteries responsables du complexe Mycobacterium avium (MAC). Ce sont en fait des micro-organismes de l’environnement, les oiseaux pouvant effectivement en etre infectes et les excreter. On les associe surtout aux elevages traditionnels et aux basses-cours familiales. Chez les humains, une exposition peut occasionner une maladie non tuberculeuse chez les sujets fragiles.
Vous venez d'écouter un extrait de l'ouvrage Les Zoonoses, publié aux éditions Quae en 2021, de Gwenaël Vourc’h, François Moutou, Serge Morand, Elsa Jourdain, lu par Baptiste Chalmel. Retrouvez ce titre et nos ouvrages au format papier et numérique sur www.quae.com.