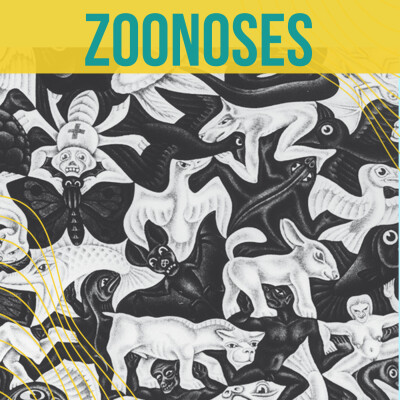Speaker #0Que savez-vous des zoonoses, ces maladies transmissibles entre les humains et les animaux ? Dans cette série d'épisodes, les éditions Quae vous proposent un éclairage sur ce sujet d'actualité. Que sont les zoonoses ? Quels animaux peuvent les transmettre ? Parmi elles, quelles sont les zoonoses virales ? Zoonoses virales La Covid-19 et autres zoonoses à coronavirus. Jusqu’au début du xxie siècle, les coronavirus étaient assez bien connus des vétérinaires, car responsables de quelques maladies importantes de l’élevage ou touchant les animaux de compagnie, mais assez peu des médecins. Côté animal, on peut citer les virus responsables de la gastro-entérite transmissible du porc, la bronchite infectieuse de la dinde ou encore la péritonite infectieuse du chat, et côté humain les virus HCoV-229E ou HCoV-OC43, responsables de rhumes en période hivernale. La simple absence de nom commun pour ces deux derniers virus est révélatrice de la modeste importance clinique et épidémiologique de ces coronavirus humains. L’émergence du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS, ou SARS en anglais), apparu en 2002 dans le sud de la Chine dans la province de Guangdong, a changé la donne. La circulation du virus, rebaptisé SARS-Cov-1 après l’apparition du SARS-CoV-2, a duré officiellement de novembre 2002 à juillet 2003, avec un bilan chiffré s’élevant à environ 8 400 cas survenus en Asie, en Europe et en Amérique, dont près de 900 décès. Le taux de létalité était donc proche de 10 %. Le virus n’est pas réapparu depuis et n’était pas connu auparavant. Les recherches conduites alors et depuis ont considérablement élargi les connaissances relatives à cette famille de virus, regroupés aujourd’hui en quatre genres, Alpha, Beta, Gamma et Deltacoronavirus. Les deux premiers genres rassemblent plutôt des virus de mammifères, les deux suivants des virus d’oiseaux. Le virus SARS-CoV-1 de 2002 est un Betacoronavirus comme le MERS-CoV et le SARS-CoV-2. L’histoire du SARS-CoV-1 semble liée à la consommation, dans le sud de la Chine surtout, d’un petit carnivore arboricole au régime volontiers frugivore, la civette palmiste masquée (Paguma larvata), qui appartient à la famille des viverridés. En effet, le point de départ de l’épidémie se situe dans les restaurants où cet animal était consommé. En Chine, les petits animaux sont achetés vivants, sur les marchés ou dans les restaurants, pour garantir leur fraîcheur aux consommateurs. Les bouchers-cuisiniers de ces restaurants ont été les premiers touchés. Ni les chasseurs de civettes sauvages, ni les éleveurs, ni les vendeurs, ni les consommateurs ne semblent se trouver à la source du phénomène. L’épidémie s’est ensuite propagée de proche en proche, et beaucoup de malades ont contaminé les soignants ou d’autres « personnes contacts ». C’est ainsi qu’un médecin chinois, venu se reposer à Hong Kong après une longue période de soins aux malades du Guangdong, a séjourné dans un hôtel international sans savoir qu’il était déjà malade. Il y a contaminé des hommes d’affaires issus de plusieurs continents qui sont repartis avec le virus. La diffusion de l’épidémie au niveau mondial est expliquée en grande partie par ce médecin qui a joué le rôle épidémiologique de « super-propagateur » (superspreader en anglais). Lui-même a été hospitalisé avant de décéder. Côté animal, si la civette correspond bien à un hôte reliant faune sauvage et humains, il n’est pas certain qu’elle soit le véritable réservoir viral. En effet, les souches isolées de malades sont toutes différentes des souches isolées de civettes. Les investigations menées ultérieurement sur les marchés, dans les exploitations agricoles et dans la faune sauvage libre de la région ont conduit à l’identification de coronavirus proches de celui responsable du SARS-CoV-1 chez de petites chauves-souris du genre Rhinolophus et montré que les virus isolés de rhinolophes, de civettes et d’humains partagent un ancêtre commun. L’origine du virus du SARS-CoV-1 doit donc se trouver du côté des virus des chauves-souris. Mais comment ce virus est-il passé des chauvessouris aux civettes et aux humains ? Comment a-t-il évolué au point de devenir pathogène pour les humains, alors que les virus proches ne semblent pathogènes ni pour les rhinolophes ni pour les civettes ? Ces questions ne sont pas élucidées à ce jour. La découverte d’un nouveau Betacoronavirus, le MERS-CoV en 2012 dans la péninsule arabique, a été une autre surprise. La transmission est toujours effective avec, fin 2019, un total de 2 502 cas confirmés, dont 861 décès depuis 2012. Le schéma épidémiologique semble comparable, avec un ancêtre viral chez des chauves-souris asiatiques (genre Taphozous) et un mammifère terrestre source des contaminations humaines, le dromadaire (Camelus dromedarius). La transmission interhumaine s’avère beaucoup moins efficace que dans le cas du SARS-CoV-1. Les nouveaux cas sont liés à des contacts avec des dromadaires infectieux. Des enquêtes sérologiques effectuées dans l’ensemble des régions hébergeant les dromadaires, des Canaries aux pays d’Asie centrale, ont révélé la présence d’anticorps un peu partout. Alors pourquoi le virus serait-il passé aux humains seulement à partir de 2012 et seulement dans les pays de la péninsule arabique ? Il n’y a pas encore de réponses à ces questions. Enfin, l’annonce d’une pneumopathie apparemment contagieuse et transmissible, d’étiologie encore inconnue, fin 2019, dans le centre de la Chine, a rappelé d’emblée quelques souvenirs aux acteurs de l’épisode du SARS-CoV-1. Il s’est malheureusement avéré qu’il s’agissait bien d’un nouveau Betacoronavirus, le SARSCoV- 2, à nouveau génétiquement proche (mais différent) de ceux des rhinolophes asiatiques. Dix-sept ans plus tard, cette nouvelle maladie, nommée Covid-19 (pour COronaVIrus Disease 2019 en anglais), provoque une nouvelle épidémie qui évolue rapidement en pandémie. Le SARS-CoV-2 se caractérise par une transmissibilité plus élevée que le SARS-CoV-1, mais, heureusement, par une létalité nettement moindre, inférieure à 1 % et probablement plus proche de 0,5 %. À la fin de l’année 2020, il est encore bien trop tôt au moment où est écrit ce livre pour répondre à toutes les questions encore en suspens quant à l’émergence de cette maladie. Les premières comparaisons des souches virales de chauves-souris et humaines suggèrent une circulation de la souche « humanisée » durant quelques années avant l’émergence identifiée médicalement. Un mammifère terrestre a-t-il joué un rôle épidémiologique dans cette émergence ? La découverte fortuite de coronavirus chez des pangolins malais (Manis javanica) de contrebande reste délicate à interpréter. La publication est antérieure au début de l’épidémie de Covid-19. Ces animaux sont vendus dans des marchés où des dizaines d’espèces sont entassées dans de très mauvaises conditions, ce qui est favorable à la transmission de micro-organismes entre espèces, humains compris. L’hypothèse de la fuite accidentelle à partir du laboratoire haute sécurité a également été avancée. S’il est vrai que de tels exemples existent (virus de la fièvre aphteuse d’un laboratoire du Royaume-Uni en 2007, virus SARS-CoV-1 de laboratoires taïwanais et chinois entre 2003 et 2004 par exemple), il n’existe pas d’éléments probants pour appuyer cette hypothèse au jour où est écrit ce livre. Plus globalement, il manque des séquences de virus suffisamment proches du SARS-CoV-2 dans le temps (analyse rétrospective) et dans l’espace (analyse géographique) pour réellement identifier son origine et les mécanismes d’émergence. On sait maintenant que la transmission du SARS-CoV-2 vers les animaux domestiques ou sauvages, mais captifs, a eu lieu dans certains contextes en Europe. En 2020, on y a signalé quelques animaux de compagnie, d’élevage ou de jardins zoologiques infectés, en particulier chez les félidés et les mustélidés, avec notamment l’infection d’élevages de visons d’Amérique (Mustela vison) par le personnel. Une possibilité de réinfection de l’humain à partir des visons infectés a été signalée. Ces contaminations ont conduit à l’abattage de l’entièreté des individus dans les élevages de visons infectés, et dans les élevages à proximité par prévention. D’autres Betacoronavirus circulent toujours dans la faune sauvage et sont d’une grande diversité. Après l’émergence de ces trois coronavirus, la possibilité d’une nouvelle émergence ne doit pas être sous-estimée. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo La fièvre hémorragique de Crimée-Congo fut décrite pour la première fois en 1944 chez des militaires soviétiques en Crimée. Le virus à l’origine de la maladie fut isolé en 1956 au Congo. Il fait partie des 25 virus pouvant causer une fièvre hémorragique virale. C’est un virus à ARN qui appartient au genre des Orthonairovirus (de la famille des Nairoviridae, ordre des Bunyavirales) et dont le nom fait référence là encore à une zone géographique, Nairobi. Le virus circule dans un cycle enzootique tique-vertébré-tique. La piqûre de tique est la principale source de transmission, mais les humains peuvent aussi se contaminer par contact avec les fluides corporels. Aussi, la distribution de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo suit globalement celle de ses principaux vecteurs, à savoir les tiques du genre Hyalomma. Ces tiques se distinguent par leurs pattes rayées de blanc et de jaune qui font qu’elles sont rapidement repérables. Le réchauffement climatique, associé à l’introduction d’Hyalomma par les oiseaux migrateurs ou le commerce international de bétail, pourrait favoriser son extension géographique. En France, H. marginatum progresse dans les régions méditerranéennes qui lui sont favorables, jusque dans le sud de l’Ardèche. En effet, contrairement à sa cousine Ixodes ricinus, cette tique aime les climats secs, la garrigue et les collines sèches. Elle diffère là encore de I. ricinus par le fait qu’elle recherche activement ses proies. Elle n’attend pas qu’un promeneur veuille bien venir à elle. Elle détecte une proie par son odeur ou les vibrations qu’elle produit et peut parcourir quelques mètres pour l’atteindre. Les principaux hôtes des larves et des nymphes de cette tique sont des petits mammifères (en particulier les lagomorphes) ou des oiseaux (en particulier les passereaux). Les tiques adultes se nourrissent quant à elles principalement sur les grands mammifères comme les chevaux, les vaches, les sangliers et les cervidés. Le virus circule dans le sang des différents vertébrés réservoirs de façon transitoire, alors que les tiques restent porteuses tout au long de leur existence et transmettent le virus à leur descendance. Actuellement, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo est signalée en Europe de l’Est et du Sud, à l’est du bassin méditerranéen, dans le nord-ouest de la Chine, en Asie centrale, au Moyen- Orient et dans plusieurs pays africains. Il y a aussi des suspicions de circulation dans les pays du Maghreb sans démonstration formelle. En Espagne, deux cas ont été identifiés en 2016, un en 2018 et deux nouveaux en 2020. Si la tique H. marginatum est bien installée en France dans le pourtour méditerranéen et progresse vers le nord, à ce jour, le virus n’y a jamais été isolé. Seule la présence d’anticorps reconnaissant ce virus chez des ruminants d’élevage a été identifiée en Corse au cours d’une étude menée de 2014 à 2016. Chez les humains, certaines infections peuvent vraisemblablement passer inaperçues, mais le taux de létalité est élevé, variant de 10 % à 40 %. Les traitements sont surtout symptomatiques, mais l’utilisation d’un antiviral peut être nécessaire. Un vaccin existe, utilisé dès les années 1970 en ex-URSS, mais procure une réponse immunitaire imparfaite. La lutte au niveau des animaux et des tiques est difficile. Aussi, dans les zones d’endémie, la prévention repose principalement sur les mesures barrières pour éviter les piqûres de tique et l’exposition au sang et aux liquides biologiques des animaux et des humains infectés. La fièvre jaune L’histoire de la fièvre jaune est intimement liée à celle des humains, malheureusement pas seulement pour de bonnes raisons. Il s’agit d’une maladie virale (Flavivirus de la famille des flaviviridés) dont l’agent est transmis par différentes espèces de moustiques propres aux régions tropicales de l’Afrique et de l’Amérique. Curieusement, les premières descriptions cliniques viennent d’Amérique, où l’on sait maintenant que le virus et la maladie ont été introduits dès le xvie siècle avec la traite des esclaves africains et le sinistre commerce triangulaire. Pendant longtemps, les Européens se contentaient d’escales le long des rivages africains sans pénétration à l’intérieur des terres. Or la zone de présence de la maladie se trouve dans les terres, pas sur les côtes. Quand on imagine les conditions des traversées d’autrefois, on pense aujourd’hui que ce ne sont sans doute pas des malades humains qui ont porté le virus d’une rive à l’autre de l’Atlantique, mais des oeufs de moustiques. En effet, les moustiques (genre Aedes) infectés peuvent transmettre le virus par leurs pontes, et les oeufs, qui peuvent donc héberger le virus, sont très résistants. La découverte au xixe siècle du rôle des moustiques dans le cycle épidémiologique de la maladie est également une étape importante dans la compréhension moderne des maladies, en particulier des arboviroses. Jusque-là on pensait à une transmission aérienne, entre malades et personnes saines. Il est aussi intéressant de constater que rapidement après l’arrivée du virus dans le Nouveau Monde, des moustiques locaux se sont montrés immédiatement compétents pour transmettre le virus, sans avoir jamais rencontré ce virus auparavant. Les Aedes se sont installés autour des zones habitées en suivant les humains, mais les espèces forestières de moustiques sud-américains (genres Haemagogus et Sabethes) ont rapidement pris le relais. On connait aujourd’hui sept genotypes differents du virus de la fievre jaune, geographiquement bien localises, cinq africains et deux americains. Les deux genotypes americains se rapprochent clairement des genotypes d’Afrique occidentale, ce qui correspond a l’histoire transatlantique de la maladie. La comparaison moleculaire des souches situe bien leur origine dans le continent africain et date la divergence des souches, qui deviendront ulterieurement les souches sud-americaines, de la moitie du second millenaire. Quant au virus de la fievre jaune lui-meme, il serait peut-etre apparu il y a 3 000 ans, quelque part en Afrique, issu d’un Flavivirus ancestral. Si les primates non humains africains sont bien réceptifs au virus, ils ne paraissent pas sensibles et n’expriment donc pas de signes cliniques. La situation est différente en Amérique, où les épidémies humaines sont régulièrement « annoncées » par des mortalités parfois spectaculaires chez diverses espèces de primates américains. Il est donc demandé aux habitants et aux visiteurs de ces régions soit d’éviter les espaces touchés, soit de n’y aller que s’ils sont correctement vaccinés. En Amérique, clairement, le schéma épidémiologique suggère donc que les singes ne sont pas réservoirs, mais que ce rôle est joué par les moustiques. La question se pose aussi en Afrique. Il existe un cycle viral sylvatique qui concerne les singes et les moustiques forestiers. Ces mêmes insectes peuvent contaminer des humains en forêt, ou dans des villages proches de zones forestières. Il existe également un cycle potentiellement urbain. D’autres espèces de moustiques, du genre Aedes, vivent au contact des humains en ville. Si un malade virémique (c’est-à-dire présentant une charge virale dans le sang) arrivant de la forêt se fait piquer par un A. aegypti par exemple, un cycle urbain peut se développer. C’est arrivé dans plusieurs grandes villes américaines bien au nord des régions tropicales. Des épidémies dans les grands ports de l’est des États-Unis ont encore fait de nombreux malades et morts jusqu’à la fin du xixe siècle. C’est aussi arrivé en Espagne (Barcelone, 1821-1822). Dans ces derniers cas, il semble que le climat tempéré ibérique, comme celui de la côte est nord-américaine, n’ait heureusement pas permis au virus de se maintenir. Une question qui intrigue les épidémiologistes est l’absence d’épidémies connues de fièvre jaune en Asie. Les échanges commerciaux entre ces deux continents sont pourtant nombreux et anciens. L’explication combinerait plusieurs causes. Les insectes vecteurs asiatiques seraient mal adaptés aux souches virales présentes dans l’est de l’Afrique. Mais il pourrait aussi exister une compétition entre les deux espèces d’Aedes, à savoir A. aegypti et A. albopictus. Le moustique A. aegypti est arrivé en Asie en traversant l’océan Atlantique, l’Amérique et l’océan Pacifique, pas directement d’Afrique. On peut aussi imaginer une immunité croisée des humains pour un autre Flavivirus dans une région géographique où le virus de la dengue circule régulièrement et depuis longtemps. Il existe un département français en zone d’endémie, la Guyane française, où la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire depuis 1967. Néanmoins, depuis 2017, trois cas autochtones ont déjà été diagnostiqués, le dernier, malheureusement fatal, en juillet 2020. Les grippes La grippe humaine est causée par des virus de la famille des orthomyxoviridés et du genre Influenzavirus, couramment rencontrés à la fois chez l’humain et chez diverses espèces d’oiseaux et de mammifères. Il existe quatre types antigéniques : A, B, C et D. Les types A et B sont à l’origine des épidémies de grippe saisonnière, et seuls les A ont à ce jour été associés à des pandémies. Les types C occasionnent des cas sporadiques de grippe et les types D, mis en évidence chez les porcs et les ruminants, ne sont pas considérés comme pathogènes chez l’humain. Nous nous intéresserons ici aux virus influenza A, car ils sont couramment rencontrés à la fois chez l’humain et chez diverses espèces animales. Ces virus présentent la capacité d’évoluer très rapidement par échange de segments d’ARN génomique, celui-ci étant composé de 8 segments séparés. Ces virus sont subdivisés en sous-types HxNy qui correspondent à différentes combinaisons de deux protéines exprimées à la surface de l’enveloppe virale : l’hémagglutinine (lettre H, classée de H1 à H18 à ce jour) et la neuraminidase (classée de N1 à N11 à ce jour). La quasi-totalité des sous-types se rencontre chez les oiseaux sauvages aquatiques, qui constituent très probablement le réservoir naturel « source » des virus influenza A présents chez les autres espèces animales, dont l’espèce humaine. La découverte de virus grippaux de sous-types nouveaux (H10N17 et H11N18) chez les chauves-souris soulève toutefois des questions sur le rôle possible des chiroptères dans l’écologie des virus influenza A. À ce jour, seuls les sous-types portant les hémagglutinines H1, H2 ou H3 et les neuraminidases N1 ou N2 se sont adaptés aux humains. Ils sont responsables de la « grippe humaine » caractérisée par une forte transmission interhumaine. Les humains peuvent par ailleurs contracter de façon sporadique des virus grippaux d’origine aviaire ou porcine : il s’agit alors de « grippes zoonotiques ». Les virus influenza des chevaux, chiens et chats ne sont en général pas zoonotiques, même si des cas de transmission ont été décrits, notamment dans le sens humain-chien. Les volailles domestiques peuvent être infectées par une grande diversité de virus influenza A qui sont excrétés dans leurs fientes. L’infection peut être cliniquement inapparente (seulement détectable par des analyses de laboratoire) ou relativement bénigne (diminution d’appétit, baisse de ponte, signes respiratoires plus ou moins discrets comme du jetage ou de la toux). Certaines souches virales sont par contre extrêmement pathogènes (on parle parfois de « peste aviaire »), provoquant une atteinte respiratoire ou digestive ou nerveuse associée à une mortalité massive et brutale. L’émergence et la forte transmissibilité de ces souches dites « hautement pathogènes » pour les volailles sont la conséquence de l’élevage industriel, caractérisé par le rassemblement en très grande densité d’oiseaux jeunes et de mêmes fonds génétiques. La transmission de ces virus hautement pathogènes aux oiseaux sauvages peut en outre avoir des conséquences graves sur la biodiversité et la conservation d’espèces en danger. Certains sous-types de virus aviaires (à ce jour H5, H7, H9 ou H10) peuvent être transmis aux humains par inhalation ou portage aux muqueuses (via les mains) de particules virales présentes sur le plumage des oiseaux. La plupart n’entraînent chez l’humain que des conjonctivites bénignes ou des troubles respiratoires transitoires, mais d’autres, en particulier de sous-types H5 et H7N9, atteignent notamment les voies respiratoires inférieures et peuvent être mortels. Concernant le virus H5N1, responsable de la « grippe aviaire » qui circule en Asie depuis 2003 et a brièvement été introduit en France en 2005, le bilan mondial au printemps 2020 montre un taux de létalité très élevé : 455 (63 %) morts sur les 861 cas cumulés identifiés depuis 2003, mais heureusement un taux de contamination global faible. Les porcs peuvent être infectés par divers sous-types de virus influenza A, les virus prédominants étant les sous-types H1N1, H1N2 et H3N2. Les porcs peuvent aussi être infectés par des virus influenza humains et aviaires. Les virus porcins peuvent acquérir des gènes issus de virus humains et aviaires par échange de segments génomiques (ou réassortiment). Ils peuvent ainsi servir d’hôtes privilégiés, favorisant l’émergence de sous-types nouveaux vis-à-vis desquels la population humaine n’est pas immunisée. Ces nouveaux virus ont alors « le champ libre » pour se propager à l’échelle globale et provoquer une pandémie grippale. C’est ce qui s’est passé en 2009 lors de l’émergence du virus A(H1N1)pdm09, non apparenté aux virus H1N1 de la grippe saisonnière en circulation dans les populations humaines depuis 1977, et qui s’est répandu sur la planète en quelques semaines. Les pouvoirs publics avaient alors mis en place en urgence une campagne de vaccination qui a été mal acceptée par la population française. En fait, la vaccination s’est avérée non indispensable, car la gravité de l’infection par ce virus grippal était finalement moindre que ce qui avait été redouté par les pouvoirs publics. Par contre, face à un virus très virulent et se propageant rapidement par voie respiratoire, la vaccination, quand elle existe, est le moyen de gestion le plus efficace pour protéger la population. La surveillance des virus grippaux porcins en circulation est donc essentielle pour que la communauté scientifique soit prête à développer de nouveaux vaccins en amont d’une possible pandémie. Ainsi, en 2020, une alerte a été donnée concernant la diffusion chez le porc d’un nouveau virus multi-réassortant, nommé « G4 reassortant EA H1N1 » et pour lequel deux cas de transmission à l’humain en Chine ont été rapportés, respectivement en 2016 et 2018, sans aucune transmission interhumaine documentée autour de ces cas. Ces émergences sporadiques soulignent l’importance de l’application en élevages porcins de mesures de biosécurité strictes afin de limiter les risques de transmission de virus influenza entre humains et porcins. L’infection par le virus West Nile Le virus West Nile, parfois appelé virus du Nil occidental, tient son nom du district West Nile, en Ouganda, où il a été isolé pour la première fois en 1937. Il appartient au genre Flavivirus, dans lequel on trouve également les virus de la dengue et de la fièvre jaune. Comme ces derniers, le virus West Nile fait partie du groupe des arbovirus. Son cycle naturel de transmission fait intervenir des oiseaux sauvages (hôtes amplificateurs) et des moustiques ornithophiles (vecteurs). Toutefois, le virus peut aussi être transmis à des mammifères par des moustiques vecteurs s’étant préalablement infectés sur des oiseaux virémiques (c’est-à-dire possédant une grande quantité de virus dans leur sang). Parmi les mammifères, l’humain et le cheval sont des espèces sensibles qui peuvent développer des symptômes allant de la simple fièvre à des encéphalites graves. Le plus souvent, cependant, l’infection est asymptomatique. Jusqu’à la fin des années 1990, la présence du virus West Nile n’a été rapportée que dans l’Ancien Monde, essentiellement en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. En 1999, le virus est soudainement apparu dans la région de New York, par un mécanisme qui demeure inconnu, provoquant des centaines de cas cliniques humains et équins ainsi qu’une forte mortalité chez les oiseaux de zoo et les oiseaux sauvages, en particulier de la famille des corvidés. Par la suite, le virus s’est propagé rapidement sur le continent américain. Les oiseaux ont servi de sentinelles pour révéler de façon précoce l’apparition du virus. Sa présence a été rapportée en 2001 au Canada, en 2002 sur la côte ouest des États-Unis, au Mexique et dans les Antilles, et en 2006 en Amérique du Sud. Les oiseaux sauvages ont probablement joué un rôle important dans cette dispersion. Cette situation épidémiologique particulière au continent américain est probablement liée à deux facteurs : d’une part, la souche virale introduite en Amérique semble particulièrement virulente et, d’autre part, elle s’est répandue sur le continent au sein d’une population d’oiseaux « naïve », c’est-à-dire n’ayant pas coévolué avec ce virus. En Europe et dans le bassin méditerranéen, la situation épidémiologique est différente, car la présence du virus est connue depuis les années 1950-1960, mais il y circule probablement depuis bien plus longtemps. Toutefois, la maladie y est considérée comme ré-émergente, car le nombre d’épidémies et d’épizooties recensées est en augmentation depuis 1994. Mais peut-être est-elle simplement mieux suivie ? En France, le virus West Nile a provoqué une épizootie équine à la fin de l’été 2000, en Camargue, après plus de trente années d’absence apparente : au total, 76 cas cliniques équins ont été confirmés, parmi lesquels un tiers ont succombé à l’infection ou ont été euthanasiés. Depuis, plusieurs épisodes de circulation du virus West Nile ont été décrits dans les départements méditerranéens du sud de la France, affectant des chevaux ou des humains. Bien que le virus West Nile ait été isolé à partir de cerveaux d’oiseaux sauvages en 2004 et en 2018, aucune mortalité anormale n’a été détectée dans l’avifaune française, contrairement à ce qui est observé aux États-Unis. La surveillance des infections à virus West Nile dans le sud de la France repose sur la combinaison de quatre volets complémentaires centrés respectivement sur les vecteurs, les oiseaux, les chevaux et les humains. Elle permet de détecter précocement la circulation du virus afin de mettre en place rapidement des mesures de prévention et de protection des personnes, principalement la sécurisation des dons de sang et des greffons. La maladie à virus Ebola Les virus Ebola portent le nom d’une rivière du nord de la République démocratique du Congo (RDC), région où a eu lieu l’un des premiers foyers d’infection humaine identifié, en 1976. Ils sont responsables de fièvres hémorragiques, un syndrome caractérisé par l’apparition brutale de fièvre, fatigue intense, maux de tête et douleurs musculaires, souvent suivis de troubles digestifs. Les signes hémorragiques peuvent aussi se manifester sur la peau et les muqueuses. La maladie est mortelle dans 25 à 90 % des cas selon les épidémies et les espèces virales. Entre 1976 et 2014, une vingtaine d’épidémies ont touché des régions isolées d’Afrique centrale (RDC, Soudan, Ouganda, Gabon). Puis une épidémie d’une ampleur sans précédent a sévi entre 2014 et 2016 en Afrique de l’Ouest, région qui avait jusqu’alors été épargnée, à l’exception d’un cas isolé en 1994. Cette épidémie a provoqué la mort de plus de 20 000 personnes. Les États-Unis et certains pays d’Europe (Espagne, Italie, Royaume-Uni) ont également été sporadiquement touchés en raison de voyageurs en provenance de cette région développant les symptômes de la maladie à leur arrivée dans ces pays. Ce sont les efforts de lutte coordonnés à l’échelle internationale qui ont permis de réduire la transmission. En 2018, une flambée a repris dans l’est de la RDC, puis une autre début 2020 dans l’ouest du pays. Les foyers humains font souvent suite à l’observation d’une mortalité inhabituelle chez des grands singes qui présentent des symptômes proches de ceux observés chez l’humain et seraient, comme lui, infectés à partir d’un réservoir animal. Une fois chez l’humain, le virus se propage par contact direct avec du sang, des sécrétions ou des liquides biologiques (salive, sueur, sperme, vomissures, matières fécales) de personnes infectées. Le risque de transmission concerne donc essentiellement la famille et le personnel soignant qui prend en charge les patients. La prévention de la transmission interhumaine repose sur l’utilisation de matériel à usage unique, l’isolement des malades et l’absence de contact avec le corps des personnes infectées, même après leur décès. Un vaccin, le VSV-ZEBOV, mis au point en 2015, est maintenant administré lors de flambées épidémiques. Outre les primates, la circulation des virus Ebola a été détectée chez diverses espèces animales, en particulier des chauves-souris frugivores de la famille des ptéropodidés. Celles-ci sont suspectées de servir d’hôte naturel pour les virus Ebola en Afrique, mais également sur les autres continents. Cependant, à ce jour, aucune preuve virologique claire du rôle des chauves-souris n’est établie. Des recherches sont nécessaires pour mieux connaître la diversité des virus Ebola chez les réservoirs sauvages et évaluer leur pathogénicité pour l’humain. En effet, certains virus Ebola, tel que le virus Ebola Reston, détecté chez des macaques et des porcs aux Philippines, peuvent infecter l’humain sans provoquer de maladie. La rage La rage du chien et du loup, le second étant la forme sauvage du premier, semble connue depuis l’Antiquité, même si l’agent responsable, le virus de la rage, n’a été identifié qu’au début du xxe siècle. Classiquement, la maladie était d’ailleurs associée à différentes espèces de carnivores selon les régions du monde et les époques. La rage du renard roux (V. vulpes) qui a sévi en France de 1968 à 1998 a été bien étudiée. Il semble que cette épizootie soit partie d’Europe centrale, peut-être de Pologne, durant les années 1930 ou 1940. Un virus canin se serait adapté au renard roux. En effet, cette rage vulpine ne semblait pas connue auparavant, ou alors seulement de manière anecdotique. Pour toutes les espèces, après une incubation de plusieurs semaines, voire de quelques mois, une phase clinique de quelques jours se déclenche et se termine toujours par la mort de l’individu malade. Il faut donc raisonner la notion de réservoir à l’échelle de la population, pas des individus. Le schéma adaptatif d’une souche virale à une espèce de mammifère donnée associe une excrétion virale dans la salive en phase clinique, voire quelques jours avant, à une modification de comportement qui favorise la transmission du virus avant la mort de chaque individu malade. C’est ainsi que dans le cas du renard roux, on a vu les animaux malades sortir en plein jour, se déplacer au hasard, attirer l’attention de leurs congénères sains, intrigués par ces attitudes. Les renards ou les familles de renards habitent des domaines vitaux assez exclusifs et en défendent les frontières par des marques olfactives. Si ces marques ne sont pas entretenues, renouvelées, si les résidents errent au hasard, les voisins vont voir ce qui se passe, tombent sur le renard enragé et se font mordre, donc contaminer. Quand passe une vague épizootique rabique, elle peut éliminer jusqu’à 90 % de la population locale de renards, qui mettra en moyenne trois à quatre ans pour retrouver ses effectifs. Ce laps de temps est en fait relativement rapide pour une espèce ayant une seule saison de reproduction avec une seule portée annuelle. Le nombre de reproducteurs parmi les survivants est élevé, la taille des portées est supérieure à la moyenne, la survie des jeunes est meilleure et les juvéniles se reproduisent plus tôt. C’est ce qui explique l’échec de toutes les stratégies de lutte contre la rage des renards par leur destruction. Le virus de la rage (genre Lyssavirus, famille des rhabdoviridés) a longtemps été considéré comme un bon exemple de virus monotypique, avec juste la souche historique, appelée maintenant RABV. Dans le courant du xxe siècle, trois espèces virales un peu différentes avaient été trouvées, toutes africaines, appelées Lagos Bat Virus (LBV), Mokola Virus (MOKV) et Duvenhage Virus (DUVV). La première et la troisième sont liées aux chiroptères, alors que le réservoir du virus Mokola, isolé de divers mammifères terrestres, n’est toujours pas connu. Les choses changent à partir des années 1980 avec la découverte successive d’une série de nouvelles « espèces » de Lyssavirus, toutes chez des chiroptères sauf une. En Europe, on peut citer EBL1 et EBL2 (pour European Bat Lyssavirus 1 et 2), BBLV (pour Bokeloh Bat Lyssavirus) ou LLEBV (pour Lleida Bat Lyssavirus). Chaque espèce virale semble associée à une espèce particulière de chauve-souris. En France, les espèces concernées sont la sérotine commune (Eptesicus serotinus) pour EBL1 depuis 1989, le murin de Natterer (Myotis nattereri) pour BBLV en 2012 et 2013 ainsi que le minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) pour LLEBV en 2017. Autant EBL1 est détectée tous les ans, autant les trois autres espèces virales semblent nettement plus exceptionnelles. En 2019, déjà 18 espèces étaient connues dans le genre Lyssavirus, et d’autres seront certainement prochainement décrites. Ces découvertes ont bouleversé les connaissances sur ces virus, mais malheureusement pas beaucoup la rage en tant que zoonose. En effet, d’un côté, il apparaît bien que les chiroptères représentent le réservoir d’origine des Lyssavirus. C’est probablement à partir des virus de chauves-souris que la rage est passée aux mammifères terrestres avec l’émergence de la souche RABV il y a sans doute bien longtemps. D’un autre côté, la découverte récente de toutes ces espèces virales correspond surtout à des isolements faits au laboratoire, le plus souvent sans lien avec des cas humains. Ces espèces viennent d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Australie. En Amérique, la seule espèce connue est RABV, y compris chez les chauves-souris, ce qui est unique. Or les cas humains répertoriés dans le monde, entre 50 000 et 60 000 décès (les chiffres sont mal connus), sont pour l’essentiel, voire la quasi-totalité, liés à des morsures de chiens. La maîtrise de la rage humaine passe donc par la maîtrise de la rage canine, c’est-à-dire le contrôle des chiens errants présents dans encore trop de pays du monde. Sont-ils toujours errants, seulement divagants, ont-ils ou non un propriétaire ? C’est souvent délicat à savoir, mais ils ne sont pas vaccinés, leur reproduction est peu ou mal encadrée et la rage circule dans leurs effectifs. La grande diversité des virus rabiques connus chez les chiroptères ne représente pas de risque pour la santé publique, car les contacts entre humains et chauves-souris sont beaucoup plus rares. Les scientifiques qui étudient ces petits mammifères volants, les chiroptérologues, sont néanmoins vaccinés, bien sûr, car ils sont conduits à les manipuler. Vous venez d'écouter un extrait de l'ouvrage Les Zoonoses, publié aux éditions Kouaï en 2021, de Gwenaël Vourc'h, François Moutou, Serge Morand, Elsa Jourdain, lu par Baptiste Chalmel. Retrouvez ce titre et nos ouvrages au format papier et numérique sur www.quae.com.