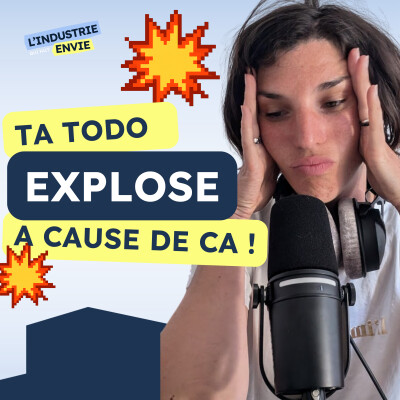- Speaker #0
Hello les passionnés d'industrie et de RH, bon ce podcast je l'ai vraiment pensé pour vous. Et son objectif, c'est de vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Et moi, je suis Claire Tonaillot, je suis hôte du podcast et fondatrice de Be Wanted. Mon objectif, c'est de faire rayonner l'industrie, enfin surtout la vôtre. Je vous aide à élaborer des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui accompagnent la croissance de votre entreprise. Mais je ne suis pas seule à ce micro, puisque chaque mois, je reçois deux invités qui vous présentent chacun quatre thématiques et donc quatre épisodes. Alors, c'est un shot de bonne pratique et de benchmark que vous trouverez dans vos oreilles chaque lundi et jeudi. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute ! Hello Olivier !
- Speaker #1
Bonjour !
- Speaker #0
Tu vas bien ?
- Speaker #1
Bien, plaisir d'être avec toi ce matin.
- Speaker #0
Mais pareillement, écoute, j'ai une confidence à te faire. Tu sais que je n'ai jamais autant bossé une interview, je te le dis.
- Speaker #1
Ah ouais, j'ai vu ça. En plus, tu as posté à l'avance en train de lire mon bouquin, tout concentré.
- Speaker #0
Regarde l'état de ton livre. Bon, pour ceux qui écoutent, vous ne le voyez pas, mais effectivement, je n'ai jamais autant corné. Bon, peut-être pendant mes études, ok, je te l'avoue. Mais sinon, je n'ai jamais autant stabiloté, écorné un bouquin et pris des photos, etc. Donc forcément, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui.
- Speaker #1
T'as toujours su m'honorer, ça veut dire que ça t'a plu quand même que t'aies allé jusqu'au bout.
- Speaker #0
Évidemment, mais je vais t'en reparler un peu plus tard. Mais ouais, j'ai trouvé effectivement le livre top et accessible aussi. donc super mais promis je t'en parle je t'en parle plus tard donc tu es l'auteur nommons-le ce livre de réindustrialiser le défi d'une génération mais tu en as écrit d'autres ensemble on va donc réaliser deux épisodes celui-ci qui sera diffusé un lundi et le second qui sera diffusé le lundi suivant alors on a une petite routine ici Donc, on commence par trois questions. C'est le moment où tu t'allonges sur le divan. La première question, c'est qu'est-ce qui t'anime, Olivier ? Qu'est-ce qui te révolte et qu'est-ce qui te fait peur ?
- Speaker #1
Comme tu l'as dit, c'est très personnel. Alors, comme on est un janvier un peu grisant, on va essayer quand même de mettre plein d'énergie à ces réponses-là. Ce qui m'anime, c'est le vivre ensemble. Alors, ces termes-là, ils ont été... été connoté dans notre façon de parler par la question du communautarisme. Moi, ce n'est pas cet angle-là que j'aime, c'est l'idée de faire communauté. Et vraiment, dans le fait que j'écrive des bouquins, que j'intervienne, c'est quelles sont nos valeurs, comment on les partage, comment on serre les coudes pour permettre qu'elles durent, qu'elles soient pérennes. Je pense qu'on est en train de rentrer dans le monde d'après, on l'avait annoncé avec le Covid. L'élection de Donald Trump, l'impérialisme industriel et économique de la Chine font que le monde d'après n'est peut-être pas celui qu'on avait espéré, mais il est là et on arrivera à y faire face que si on est soudés entre nous, s'il y a une cohésion de cette communauté. Et sans elle, je pense qu'on aura du mal à faire du rénovat. Voilà, c'est vraiment ça qui mène. Comment on fait ensemble de faire société, de faire communauté ?
- Speaker #0
Très bien. Et qu'est-ce qui te révolte alors ?
- Speaker #1
C'est la lâcheté, le cynisme. On va parler beaucoup d'industrie et récemment, il y a eu des décisions qui étaient orthogonales, par exemple, au discours politique. Le discours politique disait Ah, on va protéger l'industrie, on va la développer. Et puis, pof, on voit tomber une décision qui fait exactement le contraire. Et des fois, on se pose la question Est-ce que c'est par incompétence ou par cynisme ? Et j'ai toujours... préféré considérer que ceux qui avaient pris ces décisions étaient juste, entre guillemets, incompétents plutôt que cyniques.
- Speaker #0
Mais c'est vraiment rassurant.
- Speaker #1
Ils ont du mal avec le cynisme. Oui,
- Speaker #0
j'entends. Il faut vraiment faire un choix entre les deux, je ne sais pas.
- Speaker #1
Quand tu as ce type de décision-là, c'est des discussions, ce n'est pas que moi dans mon miroir qui m'ai posé cette question en se demandant comment ils sont arrivés à prendre de telles décisions ? Est-ce qu'ils sont incompétents ou est-ce qu'ils sont cyniques ? Voilà. J'entends,
- Speaker #0
j'entends, j'entends. Et alors, qu'est-ce qui te fait peur ?
- Speaker #1
Écoute, c'est ce que j'appelle du sang dans les rues. C'est la violence, la violence publique. Et je suis pour les réformes. Je n'aime pas les révolutions où nos sociétés, nos vies rentrent dans un mode complètement erratique de discontinuité, d'incertitude totale. Et pourtant, je crains depuis quelques mois, même quelques années, qu'on aille vers ce type de période-là à toute vitesse. Donc voilà, ça me fait peur. Je l'assume aujourd'hui. Mais j'ai peur de cette violence collective. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu les Gilets jaunes, qui étaient encore une fois une colère. Je ne juge pas sa légitimité ou pas, mais il y avait de la violence sociale. Et ça, c'est des choses qui me font peur.
- Speaker #0
Ok, je partage. La question suivante, elle va forcément te parler. Pour toi, qu'est-ce que c'est ? l'industrie qui fait envie. Qu'est-ce que ça représente ? Tu sais que c'est le nom du podcast, évidemment. Qu'est-ce que ça représente ? Je sais que tu as forcément une vision à nous partager déjà sur cette première question.
- Speaker #1
Oui, alors, mes réponses sont à l'image un petit peu de la réflexion que j'ai. Pour moi, l'industrie qui fait envie, c'est celle qui nous permet de retrouver qui nous sommes, notre culture, notre histoire. C'est l'industrie qui est juste à la bonne taille. On connaît tous le conte boucle d'or. On essaye un lit trop grand, on essaye un lit trop petit et puis on trouve le lit qui est juste à notre bonne taille. Je pense que notre histoire n'est pas celle d'une start-up nation. Ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas notre culture. On est une nation du geste, du savoir-faire, de l'ingéniosité, des grands projets aussi. On est une nation de la diversité des territoires, avec un rapport au fer. Et pour moi, retrouver l'industrie qui fait envie, c'est celle qui nous permet d'être qui on est dans notre culture et dans notre histoire, et pas autre chose, et donc d'être bien, d'être dans une forme d'équilibre.
- Speaker #0
Très bien, merci pour ce partage. Je te propose avant de plonger dans le cœur de nos sujets. C'est de te présenter comme tu le souhaites et comme tu l'entends. Voilà, tout ce que tu veux nous dire.
- Speaker #1
Tu me demandes de me présenter. En fait, il y a toujours deux manières de se présenter. Il y en a une un peu officielle avec un parcours professionnel, un statut, etc. Puis il y en a une qui est un peu plus personnelle. Donc, je vais te proposer de faire un peu les deux très rapidement. D'abord, au niveau professionnel, aujourd'hui, je suis prof au CNAM, mais c'est ma quatrième vie professionnelle. J'ai été industriel chez Saint-Gobain, donc j'ai supervisé toutes les activités en Europe centrale et orientale. C'était mon dernier job là-bas. Donc 12 pays, de la Pologne à la République tchèque jusqu'à l'Albanie et la Bulgarie dans ce polygone-là. Et puis j'ai été fonctionnaire. Alors on dit haut fonctionnaire, mais je n'aime pas ce type de terme-là parce que ça voudrait dire qu'il y a des bas fonctionnaires. Et ça, ce n'est pas beau. mais j'ai travaillé à la Commission européenne, un conseil régional, le Nord-Pas-de-Calais, et puis pour l'État central, à chaque fois avec un job de conseiller. Donc j'ai conseillé une commissaire européenne, un président de région et un président de la République parce que j'ai passé deux ans et demi à l'Élysée. Et puis aussi un job classique de fonctionnaire. Donc j'ai été scribe de bout de directive à la Commission européenne. J'ai été directeur général adjoint du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Pat Calais en charge de la formation et du développement économique. Et puis pour l'État, j'ai mis en place Territoire d'Industrie, une politique qui a été lancée par Édouard Philippe. Et puis j'ai eu une vie aussi de conseil avec deux temps. Un sur la digitalisation de l'industrie, les premières feuilles de route 4.0 qu'on a mis en place. Et puis un deuxième temps post-Covid sur les questions de sécurisation d'approvisionnement. Voilà, et puis maintenant je commence à... un job de prof au CNAM pour former des gens à faire des projets de décarbonation dans l'industrie, dans les sites industriels. Ça, c'est ma vie pro. Après, en vie perso, je vais raconter une anecdote. J'ai fait un autre webcast et c'était Thinkerview. Et j'étais avec... Louis Gallois, c'est le grand CV de l'industrie française, Airbus, SNCF, etc. Et naturellement, il s'est présenté avant moi. Et après, je me suis dit, mais comment je vais me présenter moi après un CV comme ça ? Et donc, j'ai basculé sur un sujet plus perso et je me suis présenté. Je pense que c'était à la fois spontané, mais ça me correspondait bien. Je suis un gamin de sous-préfecture aussi. Alors, je n'ai plus l'âge d'être un gamin. hélas, mais j'ai grandi dans une sous-préfecture, Albertville. J'y ai vécu heureux jusqu'à ce que je passe mon bac. Je ne dis pas que je n'ai pas été heureux après, mais j'étais bien. Et cette notion de territoire qui est maintenant au cœur de ma réflexion, quelque part, je m'en suis échappé. Je suis passé à Lyon pour mes études, puis après à Paris, puis après j'ai eu une vie internationale. Et puis finalement, je suis revenu. J'aime beaucoup cette notion et je pense que ça fait partie de mon identité. d'un ancrage territorial, d'une appartenance. Mais chacun a la sienne. Il y a beaucoup de territoires. J'aime bien ce terme. Certains commencent à le décrier. Mais je trouve que c'est juste, il y a une pluralité, un ancrage, encore une fois, une diversité. Et ça exprime aussi une appartenance. Voilà, donc je suis un gamin albervillois qui a grandi, mais qui reste attaché à ce territoire.
- Speaker #0
Très bien. Donc, je pense qu'on en reparlera, justement, de cette... Notion de territoire, en faisant le lien avec le sujet de l'industrie. Mais en tout cas, merci pour ce que tu livres. En ce moment, tu sais que je passe beaucoup de temps auprès des RH, des dirigeants industriels, des collaborateurs évidemment aussi. Et je t'avoue que tous les jours, je lis un peu l'inquiétude, les difficultés des dirigeants, la pression un peu médiatique qu'on peut avoir sur la grande famille de l'industrie. On a un contexte qui peut être un peu morose, mais pour autant, il ne faut pas forcément être dans l'abattement. Mais en ce moment, voilà, ce n'est pas simple. Sur mon territoire, justement, pour reprendre ta notion de territoire. On a des PSE qui recommencent à faire les gros titres. Les industriels qui se portaient bien jusque-là ont tendance aussi à reporter certains projets de développement, d'innovation, d'amélioration. On a une forme d'immobilisme en fait sur notre territoire en ce moment, enfin sur mon territoire en ce moment. Mais toi, tu portes un message, enfin plusieurs évidemment. On en a discuté, j'ai lu ton livre. Moi, je l'ai trouvé effectivement plutôt accessible. Au départ, je m'étais dit, ça sent le scénario un peu catastrophique, digne d'un blockbuster à l'américaine, tu vois, type 2012. Et vraiment non. Donc, c'était peut-être un biais que j'avais parce qu'effectivement, certaines industries du territoire ne sont pas en très grande forme. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que d'une part, tu poses les constats. évidemment de manière assez profonde, structurelle. Donc c'est évidemment très enrichissant. Mais au-delà de ça, tu proposes des solutions. Enfin voilà, tu ne te contentes pas de constater, il y a des solutions, il y a des choses qui sont activables à différents niveaux. Et tu vois, je ressors en fait de la lecture de ton bouquin moins abattue que je pouvais l'être. et surtout avec des pistes de solutions et des éclairages. Et je trouve que c'est un message qui est de manière générale quand même plutôt positif. Il n'y a pas d'abattement, il y a des choses à faire. Retrouve-nous les manches collectivement pour y parvenir. Tu nous rappelles dès les premières pages, si ce n'est pas la première page de ton livre d'ailleurs, que ton message, ce n'est pas de réindustrialiser pour réindustrialiser. Mais c'est vraiment une réponse et je te cite. Une réponse aux fractures sociales, territoriales, économiques. Donc la première question que je vais te poser, qui brûle un peu sur toutes les lèvres en ce moment, c'est comment va l'industrie française aujourd'hui ? Et quelles ambitions sur lesquelles on peut vraiment se projeter pour l'avenir ?
- Speaker #1
D'abord, merci d'avoir choisi cette citation, notamment sur les fractures sociales et territoriales, parce que je pense qu'elle fait écho aussi à la première question que tu m'as posée. Pourquoi est-ce que je m'engage personnellement dans ces réflexions, je dirais presque dans ce combat-là ? Je vais réutiliser ce terme un peu après. Comment va l'industrie aujourd'hui ? On est beaucoup dans une société de communication et quand on a envoyé sur le sujet, qui a donné lieu au bouquin, précédemment c'est un rapport que j'ai remis au gouvernement, on a eu une sorte de dilemme. C'était, est-ce qu'on raconte l'histoire ? qui est racontée par la sphère politique sur notre réindustrialisation où est-ce qu'on dit la vérité. Et on a décidé de dire la vérité, ça fait partie de mes valeurs. Et donc la vérité, elle est crue. et je comprends qu'elle puisse aussi quelque part un peu déprimer. La réalité, c'est qu'on a désindustrialisé, c'était un choix, qu'on a fait au milieu des années 70 et surtout qu'on a confirmé dans les années 90. En 2010, 2010 exactement, on s'est rendu compte qu'on avait été trop loin dans la désindustrialisation. Ça fait 15 ans qu'on veut réindustrialiser, trois présidents de la République, parce qu'on peut mettre Nicolas Sarkozy. dedans, 2009, c'était lui qui était président de la République, c'était juste après les crises de 2008-2009. Et quand on regarde les indicateurs, alors sans faire une loupe sur juste le moment où ça va bien, etc., on se rend compte qu'en fait, nous n'avons pas réellement réindustrialisé et qu'on n'a pas réussi et qu'on est toujours... Alors, il y a un indicateur, ce n'est pas celui que je préfère, mais c'est celui qui est le plus utilisé, qui est le pourcentage d'industrie dans une création de richesses. On est toujours à 10 même un peu moins aujourd'hui. Et... Et surtout, c'est stable, donc ça n'augmente plus. Ça n'augmente pas, ça ne baisse plus non plus, quelque part. Et puis surtout, c'est très, très faible par rapport au reste de l'Europe. Alors, il y a eu une petite période que j'appelle le printemps de l'industrie 2021-2022. C'est un mélange à la fois de rebonds après le Covid et puis d'éléments structurels, je pense, qui nous avaient mis sur une belle trajectoire. Mais à partir de 2022, notamment crise de l'énergie, on parlera aussi de France 2030. On a changé le logiciel et on a un déclin de cette croissance qu'on a connue. Et aujourd'hui, on tape le niveau zéro et on est en dessous. Donc en 2024, on a détruit des sites industriels. En 2024, on a détruit de l'emploi industriel en France. Donc notre industrie ne va pas bien. On est sur une tendance baissière depuis fin 2022. Ce n'est pas, hélas, je crois qu'un accident. Pour autant, est-ce qu'il faut désespérer ? Absolument pas. Et c'est ça. Le côté un peu superbe, en tout cas belle découverte pour moi de ce travail qu'on a fait ensemble sur la réindustrialisation, c'est qu'en fait on s'est sans doute raté de logiciel pendant ces 15 ans. Et qu'on peut assez facilement expliquer pourquoi on n'a pas réussi à réindustrialiser aussi structurellement qu'on le souhaitait. Et qu'on a un potentiel qui est celui des PMI et des ETI dans le territoire. Au début c'était une intuition. Et puis après, on l'a quantifié et même la BPI l'a quantifié. Donc la grande BPI, l'institution, celle de la Startup Nation à temps, elle a aussi doucement basculé et redécouvert ce potentiel qui est celui des PMI et des ETI de nos territoires. Toujours cet ancrage-là qui forme en fait les deux tiers de notre potentiel de réindustrialisation. Donc on pourra revenir si tu veux dessus, mais pendant 15 ans, on a voulu réindustrialiser quelque part avec les recettes. un peu modernisé des années 70, des grands plans golo-pompidoliens, on voulait devenir leader, sans avoir tout à fait revu le logiciel après 40 ans de désindustrialisation, dans un monde ouvert, dans un monde financiarisé. Et la conclusion de ça, c'est qu'on a un potentiel, celui de nos PMI, de nos ETI, on a des leviers qu'on n'est pas allé chercher parce qu'on n'y a pas pensé, on n'était pas dans le bon logiciel, et que si on... mélange ça entre ce potentiel et ces leviers dont on va parler, le foncier, le financement, la mobilisation de notre épargne, le made in France, la formation, l'image de l'industrie, l'attractivité des métiers. Si on actionne ces leviers, il n'y a pas de raison qu'on ne rejoigne pas la moyenne européenne. Alors, quand même, le pas est grand. Nous, on est à 10%, la moyenne européenne, c'est à 15%. Il faudrait qu'on augmente notre industrie de 50%, qu'on ait 50% de plus d'usines. 50% plus de personnes qui travaillent dans l'industrie simplement pour rattraper la moyenne européenne. C'est dire combien on s'est désindustrialisé. Mon sentiment, très sincèrement, ma conviction, c'est que c'est possible. Il faut juste un nouveau logiciel qu'on a essayé de proposer. Il n'est pas parfait, mais je pense qu'il y a des leviers qu'on pourrait tester dès demain, encore une fois. Et puis, le dernier point, c'est que ça va prendre du temps. Ce n'est pas un claquement de doigts. Ça va prendre, c'est le titre du bouquin, 15 ou 20 ans, le temps d'une génération. Et donc, ça a des conséquences aussi sur les priorités qu'on doit mettre en œuvre, parce que faire une politique flash de communication, ce n'est pas comme faire une politique dans la durée pendant 10 ou 15 ans. Voilà un petit peu les éléments.
- Speaker #0
Excuse-moi, avec ce que tu dis, il y a plusieurs questions qui me viennent, parce que tu évoques que finalement, on était dans une politique de désindustrialisation consciente. C'est juste pour poser un peu de contexte. Le passé, c'est le passé. Mais ça peut expliquer une partie de notre histoire, de l'héritage, de l'image qu'on peut avoir de l'industrie, etc. Donc, je pense que c'est important de s'y attarder un peu plus. Donc, comment on a pu conscientiser cette volonté de désindustrialiser ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Et quel impact, encore aujourd'hui, on peut traîner un peu comme un boulet à la pâte, quoi, tu vois ? Quel est l'héritage de ça, finalement ?
- Speaker #1
Oui, c'est une décision collective. Alors, on n'a pas fait un référendum, ni en 75, ni dans les années 90 pour le faire, mais on... On blâme beaucoup Serge Turuc avec sa fameuse phrase Je veux faire d'Alcatel un groupe industriel sans usine le fameux Fabless qui date du début des années 2000. En fait, il n'était que le porte-parole d'une pensée collective. Je vais essayer de la décrire cette pensée. Elle remonte à assez loin, elle remonte à des théories qui datent des États-Unis dans les années 50 et qui dit qu'un pays a une sorte de cycle ou en tous les cas différentes étapes dans son développement. Il est d'abord agraire. Puis après, il s'industrialise. Puis après, il devient tertiaire. Voilà. Et en fait, quelque part, ces pensées américaines des années 50 ont été traduites en France par des sociologues, Rosenvalon par exemple, qui après ont dit, je me suis sans doute un peu trompé quand ils ont pris un peu de recul. Mais au départ, ils ont popularisé, ils ont diffusé ces idées-là. Et elles ont été mises en œuvre à partir des années 70. La caractéristique de la France, comme du Royaume-Uni, mais... et qui nous fait vraiment une différence avec l'Italie et l'Allemagne, c'est qu'il y a eu un passage autour des années 90, chute du mur de Berlin, c'est encore une fois un nouveau monde, le monde s'ouvre, il n'y a pas deux blocs économiques et politiques. Nous, on a confirmé cette trajectoire économique, tandis que l'Allemagne et l'Italie, avec les Royaumes-Unis, qui a fait comme nous, et donc on a continué notre désindustrialisation jusque dans les années 2010, tandis que l'Allemagne et l'Italie ont pris une autre direction. Et le principe de base confirmé à cette époque, c'était le monde s'ouvre, les échanges économiques vont nous permettre de générer beaucoup de richesses. Et ça a été vrai. La pauvreté dans le monde a baissé grâce à la libéralisation des échanges. Et on était dans la théorie de la spécialisation économique. Nous devions être bons en R&D, en conception, et des pays plus en voie de développement. La Chine, à l'époque, devait être bonne parce qu'ils avaient des coûts plus bas dans la production. Et en fait, l'histoire ne s'est absolument pas passée comme on l'imaginait. On pensait que ça allait être un vecteur de démocratisation de l'ensemble du monde, de diffusion de notre modèle de démocratie de marché, si on peut l'appeler comme ça. L'histoire a démontré que ça n'avait pas été le cas politiquement parlant. On en fait le constat aujourd'hui, avec de plus en plus de régimes autoritaires dans le monde. Mais en revenant sur notre champ aussi, on a fait une erreur fondamentale dans la conception de cette politique. C'est que quand on coupe la recherche et le développement de la production, en fait, ça ne marche pas. On ne peut pas faire un pointillé à ce niveau-là en disant la France, l'Occident vont garder la recherche et le développement et on va délocaliser la production. Ça, c'est un super point de vue de tableur XL pour des financiers parce qu'il y a un retour sur investissement d'un côté, une valeur ajoutée d'un côté, un autre retour sur investissement, un autre type de valeur ajoutée de l'autre. Mais dans la réalité, quand on fait un produit industriel, et de toutes ces innovations, si on n'interagit pas entre ceux qui conçoivent et ceux qui fabriquent, ça ne marche pas ou c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, celui qui produit finit par avoir un avantage sur celui qui conçoit. Et c'est l'histoire de la Chine. On a transféré les productions là-bas et les Chinois sont montés en gamme, ont développé des écoles d'ingénieurs fantastiques et aujourd'hui sont devant nous en recherche et conception sur beaucoup, beaucoup de projets industriels. On s'est planté dans cette lecture de politique à la fois démocratique, sur la diffusion d'un modèle, et sur le système productif. Je pense que c'est important qu'on s'en rende compte. Et la prise de conscience de ça, peut-être pas aussi claire que celle que j'exprime, elle date des années 2010. Alors ça, c'est l'histoire, notre histoire, politique et économique, en tous les cas, autour de l'industrie. Et après, ça a des conséquences très profondes. Pendant 40 ans, On a expliqué que les usines avaient vocation à fermer. Nicolas Dufourque dit de temps en temps que les chefs d'entreprise industrielles en France aujourd'hui, ce sont des survivants. C'est des gens qui ont survécu à des décennies dans lesquelles on leur a quelque part posé la question mais qu'est-ce que vous foutez encore ici ? Vous devriez être en Chine ou au Vietnam Et l'État, il y a un très bon bouquin de Eli Cohen là-dessus, s'est transformé en État pompier. Pendant ces décennies... Il n'était pas là pour aider au développement industriel, même s'il pouvait y avoir des déclarations politiques. Il était là pour accompagner les plans sociaux qui étaient devenus la norme. C'était le sens de l'histoire de fermer des usines. Donc ça, c'est une culture très forte. 40 ans, c'est deux générations, ça nous habite et il faut quelque part se débarrasser de tout ce paquet-là qui soit conceptuel sur les politiques économiques et puis de vue sur l'industrie. Et ça nous marque tellement que c'est si tu échoues à l'école, tu iras à l'usine, qui est le lieu de relégation sociale, alors que je pense que c'est un lieu merveilleux pour s'épanouir. C'est des travaux d'équipe, il y a de l'innovation, il y a de la multicompétence, etc. Tous ceux qui sont rentrés dans des usines le savent. Mais l'image qu'on en a véhiculée, c'était le secteur qui n'avait plus sa place dans la trajectoire économique du pays. Et une des autres conséquences qu'il y a eu, et qui nous démontre l'échec de cette orientation-là, je pense, c'est que les territoires, on en revient à ça, qui vivaient autour de l'industrie, quand on vit à Albertville, on ne va pas avoir un plateau de traders ou un cabinet d'avocats d'affaires internationales. qui va faire des millions d'euros. Ce n'est simplement pas là que ça se passe dans les métropoles et c'est la fonctionnalité d'une métropole d'attirer ses talents. Par contre, à Albertville ou dans ces territoires-là, on peut avoir des superbes usines 4.0 qui apportent de la richesse, qui font de la fierté, qui font de l'ancrage, de l'identité territoriale. Et comme on a désindustrialisé, on a plein de territoires qui se sont interrogés. Mais finalement, je n'appartiens plus au récit économique de ma nation. de ma communauté. J'appartiens même peut-être plus au récit de ma nation. Je suis laissé pour compte, délaissé. Et je pense que c'est un moteur très fort des Gilets jaunes qu'on a connus en 2018. Voilà toute cette histoire et tout ce que ça laisse derrière nous dans nos pensées politiques. Et aujourd'hui, avec les PSE que tu as mentionnées, il y a des gens qui reviennent à la charge en disant Ah, mais on vous l'avait bien dit, refaire l'industrie, c'est impossible, etc. Même des gens vraiment très, très respectables. C'est pas... La personne qui veut se faire mousser juste pour prendre une déclaration un peu provocatrice. Voilà, on en est là. On a toujours, quelque part inconsciemment, cette idée qu'aller travailler dans l'industrie, c'est pas bien. L'éducation nationale est en train de changer, mais c'est une grosse machine qui change doucement. Et donc, elle véhicule cet image-là. Elle ne connaît pas les métiers industriels. On se trimballe avec tout ça.
- Speaker #0
Et tu vois, ça me fait penser à une chose que tu... enfin la manière dont tu me l'expliques là, à cette notion un peu de supériorité des fonctions qu'on peut appeler parfois encore col blanc. Tu vois, je crois que tu en parles aussi dans ton livre, les bons métiers ou les beaux métiers de l'industrie. Et tu vois, c'est un peu aussi cet héritage d'opposition entre les sachants col blanc, tu vois. Et finalement, l'école bleue, quelque part qu'on a un peu délocalisé, ou carrément délocalisé dans d'autres pays. Et ce que tu expliques, c'est que non, ça ne fonctionne pas. On n'est pas dans une position de sachant, on est au service de la production, au service du faire. Ça me fait penser vraiment à ce parallèle-là. Alors forcément, toi, d'un point de vue beaucoup plus macro, mais qu'on peut encore retrouver, illustrer. Et cette guerre qui peut encore coexister, tu vois. Et cette image qu'on a encore beaucoup trop de ce que je n'aime pas appeler l'école bleue, tu vois. Je ne sais pas ce que tu penses, mais ça me fait penser à ça.
- Speaker #1
Oui, et puis alors, on vit quand même une période où les choses sont en train de changer. Je vais t'illustrer deux choses sur ces cols bleus et cols blancs. La première chose, c'est que... Avec le Covid et le télétravail et les plateformes comme celles sur lesquelles on est, les métiers de col blanc sont devenus délocalisables. Et même avec l'intelligence artificielle, un certain nombre de métiers de col blanc sont maintenant confrontés à quelque chose que connaissent très bien ceux qui font de la production, c'est des révolutions technologiques. La mécanisation, la robotisation, la cobotisation, etc. On a connu dans les ateliers, on ne les a pas connus dans ces métiers de col blanc. Et maintenant, ils sont confrontés à ça. Donc, un, la technologie nous remet ces deux corps-là à égalité, si tu veux encore les différencier. Autre chose, en termes de salaire, tu vas dans un certain nombre d'entreprises et tu découvres que ce qu'on a appelé les cols bleus sont payés plus qu'un certain nombre et même un nombre significatif de cols blancs. Donc, la valeur, si on parle en termes économiques, et je vais revenir après sur des valeurs plus éthiques, mais en termes économiques, ces métiers-là sont... aujourd'hui, pour une grande partie, plus valorisées que les autres. Ce qui nous démontre des inversions qui sont en cours dans notre société. Je pense que c'est, tu vois, que tu peux quantifier. Et puis après, il y a la question de la valeur qu'on y met, notre valeur éthique. Et en fait, il y a plein de formes d'intelligence. Il y a plein de formes pour s'épanouir.
- Speaker #0
On peut s'épanouir dans l'intellect, on peut s'épanouir dans le faire. Des fois, je dis, on ne peut pas réaliser quelque chose avec ses mains sans utiliser son cerveau. Par contre, on peut savoir utiliser son cerveau sans utiliser ses mains. Et donc, on peut se poser la question de qui est quelque part le plus intelligent ou le plus riche pour utiliser toutes les potentialités qui nous sont données. Mais là aussi, on a un travail. Il y a quelques bouquins un peu emblématiques, comme par exemple l'éloge du carburateur ou d'autres qui sont un peu connus. Et on voit émerger ça, des gens qui ont été poussés par notre société, par notre système de formation, à valoriser uniquement, je dirais, leur cerveau, à être dans des métiers dits intellectuels, et qui ne s'y sont pas retrouvés, et qui sont heureux de revenir dans des métiers où on transforme la matière, qui a sa beauté, qui a son odeur, qui donne l'impression de réaliser quelque chose. On voit l'objet, on a l'impression de participer à une œuvre collective. Voilà. On est dans un monde de changement encore. On est juste au début, honnêtement, 40 ans, c'est deux générations. On a été marqués au feu rouge avec ça. Et donc, le temps que ça disparaisse et que ça cicatrise, c'est un énorme travail à faire.
- Speaker #1
Et justement, dans ton livre, pour les ambitions de l'industrie, de notre réindustrialisation, de notre renaissance industrielle, je dis le mot, je dis l'expression que tu emploies. Tu vas nous en parler. Tu nous présentes plusieurs scénarios. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, enfin, qu'est-ce qui te semble le plus probable ? Quels pourraient être les freins ? Voilà, je t'écoute sur cette partie-là qui est forcément prégnante dans ton livre, en fait. Je pense que c'est important qu'on s'attarde là-dessus.
- Speaker #0
Là, on était un petit peu dans les idées jusqu'à présent, dans les valeurs qu'on a envie de faire vivre, vivre ensemble, la vie des territoires, l'appartenance à un territoire, le bonheur qu'on peut avoir de faire, de réaliser, la beauté d'un objet qu'on a entre ses mains. Maintenant, on va redescendre plutôt sur des choses de macroéconomie. Quand j'ai fait cette mission, encore une fois, j'ai fait une mission pour Bercy qui a donné lieu au bouquin. Donc, quand je fais référence à cette mission, c'est celle-là. on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de simulation macroéconomique du poids de l'industrie dans l'avenir en France. On disait, il faut aller jusqu'à 15% en 2035, mais on avait lancé ce chiffre un peu en l'air, on étant quand même un ministre.
- Speaker #1
Mais excuse-moi, juste, je me permets de te couper sur ce 15%. Donc, c'était juste pour se tabler dans la moyenne de l'UE, en fait. C'est comme ça que ça a été fait, ce 15%.
- Speaker #0
En tout cas, c'est l'hypothèse. C'est-à-dire, si j'avais dit à son conseiller, Et le seul raisonnement que je peux trouver derrière le 15%, parce qu'il n'était pas documenté, c'est de dire, nous allons rejoindre la moyenne de l'Union européenne qui est autour de
- Speaker #1
15%. Et puis,
- Speaker #0
on s'est posé la question, ok, très bien, si on le fait, qu'est-ce que ça donne ? Ça veut dire, on a besoin combien en énergie, en électricité, en hectares pour mettre des nouvelles usines, en nombre de personnes à former ? On a besoin de combien en investissement supplémentaire, en milliards d'euros à investir dans des usines en France pour faire ce 15% ? Alors, on a fait le 15% et puis on savait par avance que ça nous paraissait, nous qui sommes dans le secteur, un peu très ambitieux. Et donc, on a fait aussi un scénario intermédiaire qui est le 12-13%. On a fait un scénario stable qui est on resterait à 10%. Et puis, on a fait un scénario catastrophe qui est celui en descendant jusqu'à 8%. Et on a regardé ces scénarios-là, qu'est-ce qu'ils donnaient et quelles étaient leurs conséquences et leurs besoins. Et une des découvertes, je dirais, qu'on a mises en lumière et qui a fait grincer les dents un petit peu, un petit peu beaucoup, c'est qu'en fait, le 15% à l'horizon 2035, il n'était pas possible. Il n'est pas possible. parce que nous n'aurions pas assez d'électricité décarbonée si on veut faire et la réindustrialisation et la décarbonation de l'économie. On a ralenti sur la décarbonation. Donc maintenant, on aurait peut-être assez d'électricité. Mais quand on veut faire toutes ces ambitions politiques en même temps, ça ne collait pas. Ça ne collait pas avec nos ressources en électricité décarbonée. On n'avait pas encore, à l'horizon 2035, les nouveaux réacteurs électronucléaires. Mais encore plus fondamentalement, on avait un problème de compétences. Faire 15% d'industrie dans le PIB à l'horizon 2035, c'est augmenter le nombre d'emplois industriels nets par an de 150 000, auquel il faut rajouter le remplacement de tous ceux qui partent en retraite. Et ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on injecte quelque part dans l'industrie 4 fois plus de personnes. que ce qu'on injecte aujourd'hui, que les gens qui y rentrent aujourd'hui, quatre fois plus. Alors, ça veut dire qu'il faudrait au moins doubler, voire tripler l'outil de formation. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait, alors on en reparlera, le fait que les gens qui sont formés vont bien dans l'industrie, augmenter ce taux-là qui est très faible. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire dans un claquement de doigts. Le temps de monter une formation, c'est deux, trois ans. Le temps d'avoir une génération qui est dans cette formation, c'est encore deux, trois ans. Donc, sur ta période de 10 ans, en fait, tu passes déjà la moitié du temps juste, et encore en ayant un chèque en blanc, en disant que tu réussis tout ce que tu fais. Dans la vie, ce n'est pas toujours ça. Il te faut au moins la moitié du temps juste pour te mettre sur la bonne trajectoire. L'objectif, il n'était simplement pas réalisable. Au total, ça fait 2 millions de personnes sur 10 ans à amener vers l'industrie. Quand on a un métier, on n'en change pas comme ça. Et donc, soit on fait basculer 2 millions de personnes des services vers l'industrie pendant cette période-là, ce qui est énorme, soit on envisage une immigration comme on a connu dans les années 70. Et je ne sais pas si notre pays y est prêt. Voilà, on voyait bien toutes les contradictions qu'il y avait dans cet objectif-là. Donc, on a fait plusieurs scénarios comme ça.
- Speaker #1
Mais tu vois, excuse-moi, mais je vais me positionner. Mais je trouve ça fou, en fait, ce que tu expliques. Et c'est peut-être en même temps très candide. Mais... Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on dirige une entreprise ? Dans le sens où, quelque part, quelle est la vision, l'ambition ? Et derrière, on déroule une roadmap, tu vois, un plan d'action, etc. Enfin, ce que tu décris, alors tu n'es pas obligé de me répondre, mais ce que tu décris, je le trouve parfaitement dingue. Tu vois, c'est-à-dire, on respecte un objectif et pouf, quoi. Devienne que pourra.
- Speaker #0
Je vais rajouter ça. Je vais te donner deux commentaires. Quand on a mis ça en lumière, un, on l'a fait avec un groupe de travail autour des gens de France Stratégie et on a mis neuf administrations ou para-administrations autour. Des gens de RTE pour l'électricité, des gens de l'INSEE pour la donnée, des gens de la Banque de France et puis des gens des ministères, ceux du Trésor, de l'entreprise, mais aussi de l'environnement. C'est des gens qui, d'habitude, dans leurs réunions interministérielles, ils ont tendance à... un peu à ne pas avoir les mêmes points de vue, voire être en grand désaccord. Et là, on a réussi à les faire travailler ensemble. Donc, un, on a une administration qui sait faire ses projections. Honnêtement, tu vois, c'est pas... Tu pourrais dire, ah, c'est vachement compliqué, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à modéliser, etc. Non, non, on a des gens qui, d'habitude, ne sont pas d'accord, qui se sont mis d'accord sur un modèle. Et on dit, ça, là-dessus, on peut compter dessus. C'est pas parfait. Rien n'est parfait dans ce type de modèle. Mais ça nous donne une première approche robuste des besoins et des conséquences de ces objectifs de réindustrialisation. Donc, on sait le faire. On l'a fait en trois mois. Et puis, pour aller dans ton sens, franchement, on n'aurait pas eu besoin d'une mission donnée à Olivier Lyoncy ou à Madame Y ou à Monsieur X, peu importe, pour le faire. Moi aussi, pourquoi on a attendu une mission donnée à ce qu'on appelle une personnalité qualifiée dans notre langage politique ou administratif pour faire ce boulot-là ? C'est... Je suis ravi de l'avoir fait. Je suis ravi d'avoir démontré que c'était faisable, que ce n'était pas difficile. Mais honnêtement, notre État n'avait pas besoin d'attendre cette mission, n'avait pas besoin de m'attendre.
- Speaker #1
Se poser les bonnes questions, déjà.
- Speaker #0
Maintenant, on l'a. Il y a un autre point dans ces simulations dont je voudrais parler rapidement. Là, ça ne fait pas partie de la lettre de mission, mais c'est ce qu'on m'a demandé oralement de le faire. Tu sais, on avait parlé de ce pointillé qu'en France, dans les années 70, puis après, confirmé dans les années 90, on avait découpé entre recherche et développement d'un côté et production de l'autre. Et aujourd'hui, dans notre monde, il y a des gens qui défendent une idée de pointillé qui est un peu différente, qui disent oui, oui, on va se réindustrialiser, mais le pointillé, on va le faire passer entre l'amont et l'aval. Quelque part entre les industries qui consomment beaucoup d'énergie, qui sont plutôt en amont, la chimie, la sidérurgie. l'aluminium, etc., celles qui fabriquent des matériaux, bon, celles-là, on ne les aime pas bien parce qu'elles polluent, parce qu'on a une énergie qui est chère, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas se concentrer sur l'aval ? Et, encore une fois, ce n'est pas dans la lettre de mission officielle qui a été publiée, mais on me l'a demandé explicitement à Bercy de regarder des scénarios de réindustrialisation à Val ou à Mont. Et vous trouverez ça dans le document qui a été publié par France Stratégie dans lequel il y a tous ces scénarios. Et alors, la conclusion là-dessus a été de dire en ferme... en termes de besoins et de conséquences ? Est-ce qu'on a besoin vraiment de beaucoup plus d'électricité si on fait de l'amont plutôt que de l'aval ? Beaucoup moins de gens, les industries ne sont pas à même endroit. Il y a des différences, mais elles ne sont pas marquantes. Autant je peux te dire, le scénario 15%, il n'est pas possible parce qu'on n'est pas capable de dégager les besoins, les intrants. qu'il faudrait pour ça, en foncier, en nombre de personnes formées, voire en électricité, autant sur les deux scénarios entre amont et aval, ce n'est pas différent. Il y a une différence, c'est évident, ce ne sont pas les mêmes territoires, ce ne sont pas les mêmes formations, ce ne sont pas les mêmes besoins d'énergie, mais ce n'est pas quelque chose où je dis ça c'est impossible. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est plus qualitatif, c'est que je me suis rendu compte que pour développer de l'innovation, et ça c'était unanime dans les 70 ou 80 interviews que j'ai faits, tu as besoin de matériaux innovants. Si tu te concentres que sur l'aval, que sur l'assemblage, la partie, je dirais, propre, on est presque dans le concept du col blanc de l'industrie, du col blanc-bleu, dans ces cas-là, en fait, tu n'es pas innovant. Il y a une histoire qui s'est passée sur le fait qu'on a délocalisé la production et en fait, la Chine a reconstruit une conception et une ERD dessus. Je suis absolument convaincu que si on finit de délocaliser nos industries à mot, la sidérurgie, l'aluminium, la chimie, il se passera exactement la même chose. En fait, il y a une sorte de continuité qui n'est pas du tout valorisée dans nos tableurs Excel de financiarisation. Parce qu'encore une fois, tu prends une usine, un bout de la chaîne de valeur, tu y mets un ROI, une valeur ajoutée, tu dis ça, je pourrais le faire ailleurs. Non, non. En fait, la vraie vie n'est pas une vie dans un tableur Excel de finance. Tu découpes en petits morceaux une chaîne de valeur.
- Speaker #1
C'est une chaîne de valeur. Il y a une continuité. Complètement. On ne peut pas tout décorrérer. Mais tu vois...
- Speaker #0
Ça, c'est un risque qu'on a aujourd'hui. Il y a un discours qui dit, oui, la réindustrialisation, mais seulement par l'aval, parce que ça consomme moins d'énergie, parce que ça pollue moins, on n'a pas besoin de remettre en cause notre politique énergétique, etc., etc., etc.
- Speaker #1
Mais si je peux me permettre, tu développes aussi ce point dans ton livre. Notamment, je fais le parallèle plutôt avec l'aspect environnemental. Tu expliques qu'on s'est mis un bandeau sur les yeux en délinqualisant aussi une partie... de nos usines, effectivement, notamment de cette filière amont, parce que pour nous, Européens, Occidentaux, oui, c'est jugé trop polluant, trop consommateur en énergie, mais finalement, elles sont bien faites ailleurs et on devient dépendant de ces filières. Et tu expliques aussi l'impact, finalement, du coût des transports sur l'environnement. Alors que je crois qu'à un moment, tu fais une démonstration, excuse-moi, mais tu fais une démonstration exacte sur l'impact du coût des transports versus l'impact de la production de ces filières à amont dans notre territoire national. Et le deuxième point, tu fais aussi le lien avec ce que tu appelles les filières principales. Alors, ce n'est pas exactement le terme, je crois que tu utilises, je ne l'ai plus exactement. Essentiel. Et filière essentielle, voilà. et encore une fois on en revient à cette histoire de boucle de chaîne de valeur je veux bien que tu nous expliques un petit peu plus en détail ces différentes démonstrations qui font un lien précis à mon sens avec le point précédent le
- Speaker #0
premier point et là je reviens un peu à une forme j'utilisais un mot qui est cru mais une forme d'hypocrisie que nous avons eu collectivement alors on a cru dans les années 70 10 qu'en délocalisant la production vers des pays qu'on appelait à l'époque en voie de développement, on leur permettrait de se développer. Dans les années 90, chute du mur de Berlin, c'était la victoire du modèle de la démocratie de marché. Et donc on a pensé que tous ces pays-là basculeraient dans une démocratie, que cette démocratie ferait naître une lutte sociale, comme celle qu'on a connue notamment en Europe, et donc de meilleures conditions sociales, qu'elle ferait émerger une élite très sensible au sujet environnemental. et que quelque part, ces pays-là suivraient la même trajectoire que l'Europe, c'est-à-dire seraient de plus en plus sensibles aux sujets environnementaux. Je vais utiliser un terme un peu fort, mais on a été européano-centrés, c'est-à-dire notre modèle, on a pensé qu'il allait se développer ailleurs.
- Speaker #1
On parle encore de supériorité, excuse-moi, mais les bons occidentaux avec le bon modèle, la bonne forme de pensée qu'on souhaite imposer au reste du monde un peu, tu vois ?
- Speaker #0
Tout à fait. Et donc, si on sort du jugement, je ne peux pas dire s'il se passe, je vais éviter de dire maintenant ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine ou ailleurs, ou en Inde, et bien ou pas bien. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, si tu veux, c'est que cette convergence qu'on avait espérée. Et je pense que les gens, dans les années 90, c'était sincère. Quand ils ont décidé de faire la mondialisation, la désindustrialisation de la France, ils étaient sincères en disant oui, je crois vraiment que ce modèle va se réaliser On est une cinquantaine d'années après, il ne s'est pas réalisé, il faut en tirer les conséquences. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et tu peux prendre de la fast fashion et on a plein d'exemples, ce qui s'est passé au Bangladesh il y a une dizaine d'années avec un atelier qui a pris feu, il y avait des conditions de travail exécrables et des conditions de sécurité nulles. Mais c'est pas que maintenant, Shine, c'est aussi des histoires qu'on connaît depuis dix ans. En fait, on a été extrêmement hypocrite en délocalisant cette production. On a aussi délocalisé et nos pollutions qui se font là-bas. La délocalisation de l'industrie pharmaceutique en Inde est liée à une réglementation qui est moins exigeante sur les effluents en eau. Donc, clairement, quand on fait la même capacité de production d'un médicament en Europe ou en Inde, on investit 30% moins en Inde parce qu'il y a... Il n'y a pas d'investissement ou moins d'investissement de dépollution. C'est un calcul économique assez simple. Et donc, on l'a délocalisé, cette pollution, en disant à un moment donné, ils vont suivre une trajectoire comme la nôtre. Et puis, on a laissé aussi faire des conditions sociales qui sont inacceptables, inavouables. Encore une fois, il y a maintenant des reportages qui se font. Quand on rentre dans les ateliers de production des jeans, etc., dans ces pays-là, on se dit, mais comment ? On n'aurait jamais accepté. ça chez nous. Le fait de délocaliser quelque chose qu'on n'accepte pas chez nous, j'appelle ça quand même une grande hypocrisie auquel on doit mettre un terme. Alors après, la question, et c'est la deuxième question, c'est sur quoi on va travailler d'abord ? On a ce concept de filière stratégique. Il est très mal défini, en fait. Il n'y a pas de définition officielle de ce que c'est qu'une filière stratégique. Pourtant, c'est un pilier de notre politique industrielle. Et si on veut essayer un peu à posteriori d'imaginer qu'est-ce qu'il y avait derrière ça, on peut se dire que c'est une filière sur laquelle on a un avantage compétitif ou comparatif, parce qu'on a la techno, parce qu'on a le savoir-faire, parce qu'on a une bonne structure de coût, etc. Et qui nous permettrait de nous projeter dans un monde mondialisé. C'est typiquement la belle filière stratégique, c'est celle de l'aéronautique avec Airbus. Mais on a aussi peut-être le naval. avec des très belles performances, des chantiers de l'Atlantique ou de Naval Group.
- Speaker #1
Tu cites toutes les grosses boîtes qui sont sur mon territoire. Excuse-moi, c'est le moment où je fais un peu de chauvinisme. Écoute, ici, on a 20 minutes des chantiers de l'Atlantique, à 20 minutes d'un citerbus, à 30 minutes de l'autre. On est chez moi.
- Speaker #0
Je vais peut-être, dans ces cas-là, te remettre un petit peu en cause. Ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est... En fait, cette façon de réfléchir sur ce qui était stratégique pour notre industrie, il est dans un contexte, c'est celui de la mondialisation, qui était celle qu'on a connue jusqu'à assez récemment, et dans laquelle aujourd'hui, clairement, on n'est plus, en tous les cas, c'est plus l'âge d'or de la mondialisation. Et j'essaye de me dire, ok, c'était très bien de développer des filières stratégiques dans un monde qui se mondialisait, où on pouvait prendre des positions sur des marchés mondiaux, typiquement l'aéronautique, avec Airbus, etc. Mais aujourd'hui, quel est l'enjeu qu'on a collectivement ? Et je pense que l'enjeu qu'on a, c'est que nos sociétés sont en train de rentrer dans des phases de crise, de multi-crise, on dit même de permacrise. Grosso modo, notre modèle de société, nos valeurs, elles vont être boxées pendant des décennies par tout ce qui nous arrive. Et on le voit aujourd'hui, c'est le Covid, c'est la crise de l'énergie, c'est l'Ukraine, c'est la position de l'administration Trump de temps en temps. Notre mode de vie, nos valeurs européennes et françaises, elles vont être boxées. Et la question que je me suis posée, c'est, dans ce contexte-là, de crise continue environnementale, migratoire, on peut aussi parler de toute la dimension des crises environnementales qui nous attendent, en plus des crises géopolitiques ou géoéconomiques. La question que je me suis posée, c'est finalement, notre outil productif, comment il faut le dimensionner par rapport à ça ? Quel est le bon outil productif qu'il faudrait pour faire face ? à ce type de nouvelles situations, de nouveaux paradigmes. Et on a lancé, je ne suis pas le seul, avec Jérôme Cuny, Anaïs Vagilis et Léonore Blondeau, un concept qui est les productions essentielles. En se disant, avant on avait des productions qu'on appelait stratégies qui nous permettaient de nous projeter avec nos avantages, nos forces, dans un monde global. Très bien. Le monde n'est plus celui-là, ou il est moins celui-là. Maintenant, il est un monde de crise. Quelles sont les productions dont on a besoin en France ou en Europe ? Et là, on peut définir le périmètre comme on veut. Mais qui vont nous permettre à notre modèle de société, à nos valeurs, aux choses dans lesquelles on croit, de tenir face à un monde où on va être boxé, où il va y avoir des crises en continu ? Et d'où le concept de production essentielle, celle qui va nous permettre d'être solide, d'être robuste, résilient, si on veut utiliser ce terme, dans les décennies à venir. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'espère que je l'ai exprimé clairement. Ce n'est pas trop difficile à exprimer en tous les cas, mais définir exactement la liste, c'est super compliqué. Alors dedans, il y a des produits qui vont être des produits de haute technologie. Par exemple, les missiles supersoniques qu'ont développé les Russes. c'est peut-être un produit essentiel parce qu'on rentre dans un univers où il risque d'y avoir des conflits militaires. On va avoir besoin de se défendre, de se protéger. Et aujourd'hui, ça demande des produits de haute technologie, ce type de guerre-là. Mais d'un autre côté, on peut se poser la question si, et on l'a vu avec les masques par exemple, un masque, ce n'est pas un produit de haute technologie, ou les respirateurs, c'est un produit de technologie intermédiaire, que... il va falloir qu'on développe des productions qui ne sont pas que des productions de haute technologie ou de valeur ajoutée.
- Speaker #1
Oui,
- Speaker #0
ou de la...
- Speaker #1
Je ne sais pas, des cartes électroniques. Moi, je connais plein de clients qui ont été en grande difficulté d'appro sur des cartes électroniques et derrière qui ne pouvaient plus rien faire sans ces fameuses cartes. J'imagine qu'effectivement, c'est un sac de nœuds. Enfin, excuse-moi.
- Speaker #0
Et on peut même descendre sur l'agriculture. Tu vois, on est complètement dépendant de végétaux protéagineux comme le soja. qui sert à nos filières alimentaires ? Bon, encore une fois, je ne sais pas s'il faut le mettre dans la liste, mais il faut considérer que peut-être demain, on aura besoin de telles filières parce qu'elles sont liées à notre souveraineté alimentaire, à notre souveraineté tout court. Et cette interrogation-là, donc tu vas voir vraiment des produits de base, des produits technologiques et des produits intermédiaires. Donc en fait, la valeur ajoutée du produit, son niveau technologique, n'est plus un bon critère de savoir où tu dois te positionner. C'est, est-ce qu'il est essentiel à la résilience, à la robustesse de ta société ? Est-ce qu'il va nous permettre de passer à travers la future crise du Covid, une autre guerre qui pourrait se passer au Moyen-Orient, etc. ? Et ça, c'est un travail qui est devant nous et sur lesquels, on a commencé à le faire partiellement, mais qui permet de redéfinir de nouvelles priorités de politique industrielle, là où on aimerait que notre outil productif soit. pour nous rendre résistants au monde de demain.
- Speaker #1
Très clair. J'ai une question un peu provoquante.
- Speaker #0
C'est maintenant. J'ai vu bien.
- Speaker #1
Bon, Christophe Castaner a fait les gros titres au mois de décembre. Tu en as parlé de cet acteur protagoniste incontournable de la fast fashion aujourd'hui, j'ai nommé Shein. Il les a rejoints. Enfin, en partie, j'imagine, dans ses activités. Et il est conseiller RSE pour Chine. Qu'est-ce que, pour toi, ça dit un peu de... Est-ce que ça vient encore une fois illustrer un peu, soit, une forme d'abattement un peu du gouvernement ou de nos puissances étatiques, en tout cas, face à l'industrie ? Un désintérêt ? Je ne sais pas. je trouve que c'est un signal pour ma part assez inquiétant voilà,
- Speaker #0
je viens de questionner là-dessus c'est effectivement une question un peu difficile parce que dans mon positionnement public je refuse la polémique personnelle t'es pas obligé de répondre tu as besoin de me le dire je vais essayer de rester sur des points un peu que ce choix personnel qui lui appartient euh... posent un peu collectivement. La première chose, c'est que la fast fashion est sans doute le contre-exemple de ce qu'on devrait faire collectivement. On est à l'extrême du consumérisme, on est dans une société qui a six des neuf limites planétaires dépassées, on était dans une société de consommation de masse, on sait que ce n'est pas durable, que ce n'est pas soutenable, on a des besoins qui ont été créés par du marketing. qui ne répondent pas toujours à des besoins fondamentaux. On a créé du désir de consommer, on a pensé pendant longtemps qu'on serait heureux en étant des consommateurs assouvis. En fait, c'est une espèce de tonneau de dédaillé, on peut continuer, continuer, continuer, et on sait qu'on ne peut pas continuer par rapport aux limites planétaires. Donc la fast-faction qui utilise tous les mécanismes qu'on peut connaître du marketing, pour moi, ne va pas dans la bonne direction dans son concept. La deuxième chose, c'est qu'elle utilise... tous les biais du commerce international. La Poste, qui en dessous de 150 euros, ne fait pas payer la TVA. Le fait que la Chine est toujours considérée comme une nation en développement. Donc, en fait, le colis de la Chine à la France est payé en partie par l'Union internationale des Postes. Il y a plein de choses comme ça. Toutes les astuces du commerce international de coûts de production très faibles, etc. sont mobilisées là-dessus dans une logique qui était sans doute celle qu'on a voulu dans les années 90, mais qui n'est plus. celle de notre monde d'aujourd'hui. et qui a donné lieu, par exemple, à la quasi-disparition du textile en France. Donc on est à la fois sur un modèle économique et sur un modèle de société qui, pour moi, sont disjoints des enjeux auxquels on fait face. Ça, c'est pour poser, pour moi, le débat de la fast fashion. Et il y avait un bout de loi qui avait été voté dans un premier temps, qui n'a pas été jusqu'au bout avec la dissolution sur ces sujets-là, qui nous montrerait que, collectivement, si elle allait jusqu'au bout, ce que je souhaite, on commence à réagir. Ensuite, le choix de la façon dont ça a été présenté, ce choix de rejoindre cette entreprise et notamment sur la RSE, c'est de dire oui, mais de l'intérieur, je pourrais avoir plus d'influence sur ce qui se passe. Là, je suis aussi en désaccord, encore une fois, pas sur le choix individuel, je ne veux pas me prononcer, mais sur la logique qui est présentée. Je pense qu'on est aujourd'hui dans un monde de combat. L'idée qu'on pouvait transformer les choses de l'intérieur, que le commerce international allait nous apporter les meilleurs biens, la meilleure qualité au meilleur prix, et que doucement il évoluerait vers nos valeurs de projet, de modèle social et d'ambition environnementale. Ce que je disais tout à l'heure, qui a été le moteur de notre modèle économique, de l'OMC, des accords de Paris, donc années 90, années 2010. Ce mode de fonctionnement aujourd'hui, je crois qu'il est issu, il ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on va rentrer dans un monde de confrontation. On aime ou on n'aime pas Trump, mais c'est véritablement le mode de relation qu'il impose au monde. On a des valeurs, il a des valeurs, on n'est pas obligé de les partager, mais on n'est plus à discuter autour d'une table, on est dans un monde de rapports de force, de confrontation, et ça, il faut l'intégrer. Quand on n'aime pas quelque chose, il faut aller au contact, aller au combat et ne pas s'imaginer qu'en contournant par derrière et en rentrant par la porte dérobée, on pourra réellement changer les choses. Parce qu'encore une fois, nos modèles de société, nos projets de société ne sont plus convergents. On a des intérêts qui sont divergents et à ce moment-là, il faut assumer cette divergence, aller à la confrontation. Ça va nous donner des décennies qui ne vont pas être simples. Pas celle auquel on a été habitué, pas celle pour lesquelles on a été formé, formaté même dans notre tête. Mais on va devoir gérer de plus en plus de rapports de force. Je peux te prendre un autre exemple, dans le même ordre de grandeur, sur un autre politique. Et encore une fois, je ne juge pas l'homme, j'essaie de prendre un repas sur le discours. Sébastien Séjourné est devenu le commissaire français au niveau de la Commission européenne. Il a été assez silencieux pendant le début de son mandat et puis là, il a pris la parole, notamment par rapport aux positions de Trump sur les taxes vis-à-vis de la Chine, mais y compris de l'Europe. Et dans sa prise de parole d'il y a quelques jours, il démarre en disant Oui, mais les États-Unis partent d'une position de force parce qu'on exporte beaucoup aux États-Unis plus qu'ils n'y portent. Mais comment on rentre dans une négociation en reconnaissant que ton adversaire, est en position de force. Enfin, tu te mets en position de faiblesse. Ce type d'attitude politique ne peut plus fonctionner. On défend nos valeurs. Et en plus, on parle que de quand on dit que les exports et les imports sont favorables aux États-Unis parce qu'on exporte beaucoup, globalement, l'Europe. On exporte beaucoup vers les États-Unis. On oublie de dire qu'on rééquilibre ça beaucoup par des transferts financiers où là, l'argent va vers les États-Unis pour des investissements, pour des retours de dividendes, pour des retours commerciaux, etc. Et quand on fait la somme des deux, ça s'équilibre à peu près. Donc, le commerce, ce n'est pas que le commerce de biens, c'est aussi toutes les transactions. Et quand tu prends une transaction, on n'est pas du tout sur la même équation. Voilà, c'est typiquement ça. On pense encore qu'on est dans un monde de l'OMC des années 90, où on va se mettre autour de la table et on va converger. Ça peut marcher si on avait la même direction, le même horizon. Et le chemin aurait pu être chahuté, il y aurait eu plein de cailloux à contourner, mais on aurait eu le même horizon. Aujourd'hui, nous n'avons plus le même horizon et nous allons devoir défendre nos valeurs, notre modèle de société, notre projet européen qui est composé d'un modèle social, d'ambition environnementale, d'une notion éthique du commerce. Quand on refuse d'acheter du gaz en Russie, alors qu'il est deux fois moins cher que celui qu'on achète aujourd'hui, on fait un vrai choix de valeurs, c'est nous, c'est nos valeurs. Et ça, il va falloir le défendre. On rentre dans une période de combat dans lequel je crois que ce type de position entre les deux ne soit plus justifiable.
- Speaker #1
Écoute, j'ai encore 15 000 questions à te poser, mais je vois l'heure qui tourne. Tu vois, j'aurais aimé aborder notamment les sujets un peu plus précis sur l'Europe, sur tout ce qui... qui est normatif. J'ai vraiment tout un tas de questions, mais je t'ai que pour un temps restreint en face de moi. Est-ce que toi, tu as quelque chose vraiment que tu souhaites ajouter sur ces grands thèmes-là ? Ou est-ce que tu es OK pour qu'on passe à l'épisode 2 ?
- Speaker #0
Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que j'aimerais bien aborder un petit peu là. C'est... Je dis souvent on est dans le monde d'après, mais je ne sais pas si tu as remarqué, je n'y mets pas d'adjectif, je ne le qualifie pas parce que je ne suis incapable de le faire.
- Speaker #1
D'ailleurs, je sais exactement ce que tu exprimes. Je crois qu'effectivement, dans ton livre, quand tu parles du monde d'après, tu exprimes bien, je ne sais pas ce qu'il sera, mais on doit nous adapter et on doit l'anticiper. C'est un peu ton message, mais oui.
- Speaker #0
Et là-dessus, en fait, on a... Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas cette prétention-là, vraiment. Mais on a essayé de s'intéresser à quelques-uns, à comment on définissait un petit peu ce monde d'après, etc. Avec l'idée, si tu me définis le monde d'après, moi, je te dessine l'outil productif qu'il y a besoin pour le faire. Et ça, par contre, si tu me dis quels sont les objectifs d'une société, je suis sûr qu'à quelques-uns, on se met autour de la table et on est capable de faire une première esquisse de l'outil productif dont on a besoin pour atteindre ses objectifs. Mais on a beaucoup de mal à le faire, en grands termes, en modèle social, en ambition environnementale. Mais tu vois, ça reste quand même très, très conceptuel. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à faire cet exercice-là, ni dans des groupes de travail, ni collectivement. Et j'en suis arrivé à l'idée, en fait, qu'on est en train de changer de façon de faire. Quand on a fait la Révolution française, par exemple, il y avait un bouquin qui s'appelait Du contrat social de Rousseau qui a été édité 30 ans auparavant et qui a servi un petit peu de guide. Je vais être provoque et je dirais que la révolution chinoise ou communiste avait son petit livre rouge avec les extraits de Karl Marx et de penseurs qui avaient pensé, qui avaient fait un système philosophique sur un autre mode de société. Et nous, on est en train de rentrer dans une nouvelle société et on n'a pas ça. Alors, je ne suis pas le seul à le dire. Michel Serres, qui est un philosophe que j'adore, qui est décédé en 2019, quelques semaines avant sa disparition. Je disais exactement ça dans un podcast sur France Inter. Donc, je me cache derrière Michel Serres pour vous affirmer ça. Et je suis arrivé à la conviction, en fait, que ce monde qui est en face de nous, on va le construire de manière pointilliste. C'est dans chacune de nos vies, dans chacun de nos territoires, qu'on va tester des choses et que doucement, elles vont s'agglomérer pour nous faire un modèle. Ça ne va pas être la valeur d'en haut dont on déduit les choses. Et on adore ça dans la culture française. On adore ça. On a un grand principe, puis après on décline, etc. Là, ça va être beaucoup plus. On fait des choses, on les expérimente dans la vie vraie, c'est-à-dire pas dans des bureaux, pas dans des cabinets ministériels. Et puis si ça marche, si ça prend, ça veut dire que ça répond à nos valeurs, à nos envies. Et quand je dis ça, ça veut dire concrètement, j'invite chacun d'entre nous à se projeter là-dedans. C'est-à-dire que nous avons, c'est ce que j'appelle les faiseurs et les faiseuses, que j'ai appelé aussi les néo-industriels. Nous avons ce rôle dans ce que nous aimons, là, moi j'aime l'industrie, d'essayer d'inventer des nouveaux modèles d'affaires, des nouvelles organisations du travail, des nouvelles relations à la nature, avec la circularité, qui répondent à ces valeurs émergentes qu'on n'a pas encore réussi à mettre ensemble pour faire un modèle cohérent, mais on va devoir avancer sans avoir ce modèle cohérent. Et donc, l'implication de chacun d'entre nous, là-dedans, et je suis très admiratif de ceux que j'ai appelés les néo-industriels, c'est les... C'est des entrepreneurs qui essayent de produire différemment, de répondre à des enjeux de société, d'environnement, de souveraineté, de développement local. Et ces gens-là sont en train de construire de manière pointilliste le tableau de notre société de demain. Il ne faut pas s'attendre à avoir la vérité vraie. Je crois qu'on ne l'aura pas, qu'on va faire cette transition, cette révolution en tâtonnant et qu'il faut l'accepter. Ce n'est pas quelque chose de facile pour notre culture.
- Speaker #1
Je te cite, tu dis dans ton livre, nous passons d'une société de consommation, voire de consommation de masse, à un autre projet de société qui ne porte pas encore de nom et que par défaut, nous appelons le monde d'après.
- Speaker #0
Et que nous allons construire tous et toutes, encore une fois, par notre engagement, par ce que l'on fait dans nos territoires, dans nos vies. Et il n'y a pas de petit livre du monde d'après. On va le construire et c'est assez perturbant. On est dans le virage et on n'a pas la carte. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident à vivre pour nous. Mais encore une fois, je suis admiratif de cette énergie que je retrouve dans chaque territoire. Il y a des pépites de PMI. Je parle de la PMI. On peut peut-être... de parler de l'enseignement ou des services. Je connais moins ces secteurs-là, donc je parle de l'industrie. Mais moi, je suis admiratif. Hier, j'ai fait un podcast avec l'Union française des textiles. Ils nous ont baladés, ils nous ont fait un tour de France de textiles techniques. Mais il y a des merveilles dans nos territoires. Des gens qui sont innovants pour la santé, pour l'environnement, qui sont déjà en circularité. Voilà, c'est eux qui sont en train de construire cet outil productif de demain. Après, ils seront suivis par les très grands groupes. Mais c'est eux nos éclaireurs. C'est eux qui nous montrent le chemin. Et quelque part, n'attendons pas d'avoir le petit livre, quelle que soit sa couleur, vert, blanc, rouge, rose, tout ce que vous voulez. Il y a un engagement à faire. Et moi, je suis plutôt grand corps d'État, fonctionnaire et grand groupe. Mais je pense que c'est là qu'il y a cette ressource qui est en train de nous faire faire cette transition, ce virage. On dit parfois cette bifurcation.
- Speaker #1
Olivier, merci.
- Speaker #0
Merci à toi.
- Speaker #1
Je te propose qu'on se retrouve pour l'épisode 2, qui sera publié lundi prochain. Et dans le deuxième épisode, on va vraiment faire un focus sur la partie qui me tient particulièrement à cœur, tu le sais bien, de l'attractivité de l'image de l'industrie. Merci Olivier, à lundi.
- Speaker #0
Merci à toi.
- Speaker #1
Bye. Nous voilà déjà à la fin de l'épisode, mais merci de nous avoir écoutés. C'était Claire Tenayau, fondatrice de Be Wanted. L'épisode vous a plu ? On se retrouve lundi pour l'épisode numéro 2. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur Spotify et surtout la meilleure façon de soutenir le podcast, c'est de laisser un avis 5 étoiles. À bientôt !